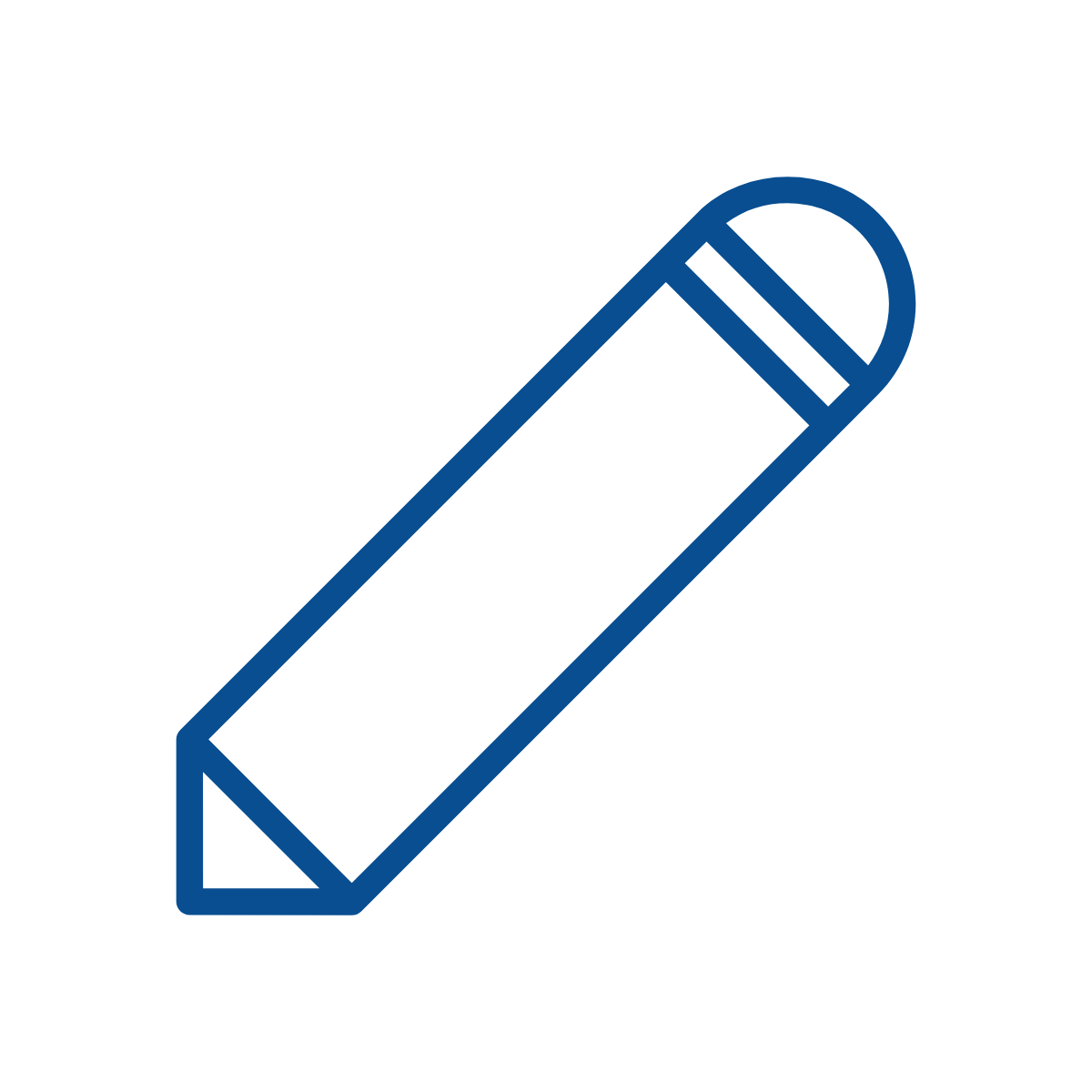-
Partager cette page
Projet d'architecture 3.11 : UN - Urban Nature
Titulaire(s) du cours
Mar Nadia CASABELLA ALVAREZ (Coordonnateur) et Axel FISHERCrédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
anglais, français
Contenu du cours
L’unité d'enseignement UN - Urban Nature est un "atelier vertical" de Projet d’architecture ouvert aux étudiant·es de Bachelier "poursuite de cursus" (voir la fiche de cours dédiée: 3.11), Master 1 (voir la fiche de cours dédiée: 4.11) et Master 2 (voir la fiche de cours dédiée: 5.11).
UN – Urban Nature mise sur une reconfiguration entre urbanisation et nature, entre humains et non-humains dans la manière d'habiter la Terre.
La modernité, fondée sur un « grand partage » entre humains et la terre animée, a établi une mise à distance entre habitat humain et nature, manifeste dans l'organisation des villes autant que des campagnes et qui pourrait aujourd’hui avoir perdu sa raison d’être.
Plus que l’application d’outils et de solutions connus, UN – Urban Nature se propose comme espace d’une « exploration holistique imparfaite d’un problème holistique qui nous dépasse », afin d'apprendre à imaginer une approche à l'architecture et à l'urbanisme susceptible d'intégrer un glissement de paradigme.
Ainsi, la "ville" ne s'oppose pas tant à la nature qu'elle y est imbriquée.
Que faire alors de l'opposition séculaire qui définissait les villes comme l'environnement artificiel par excellence, dont la nature (ses aléas, ses dangers, ...) est exclue ?
Que faire de la dichotomie ville/campagne dès lors que la survie des villes dépend de territoires de plus en plus vastes et éloignés, reliés par des chaînes d'approvisionnement complexes et proliférant à l'infini : peut-on encore qualifier ces territoires de "ruraux", au sens traditionnel d'un territoire subordonné, en retard sur le plan du progrès et fondamentalement sous-théorisé par les architectes ?
La notion de "rural" conserve-t-elle encore une quelconque validité pour appréhender la réalité de ces territoires excentrés, hantés par leur passé et secoués par les dynamiques contemporaines d'interconnexion mondiale ?
UN – Urban Nature participe au projet NeRu (newruralities.eu), un partenariat de coopération Erasmus+ (2022–25) entre 6 équipe d'enseignant·es et leurs étudiant·es d'autant d'universités européennes: ULB, Politecnico di Torino (Italie), Universidade da Coruña (Espagne), Universidade do Minho (Portugal), Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija of Sofia (Bugarie), ainsi que ETH Zürich (Suisse).
NeRu s'attache à reconceptualiser les territoires ruraux au-delà de l'opposition villes-campagnes, retenue comme l'une des causes de l'actuelle crise climatique, et ce afin d'enrichir les programmes de formation des architectes et urbanistes.
Cette année académique 2023–24, l'unité UN – Urban Nature part de l'hypothèse que les territoires ruraux sont constitués d'une couche pré-moderne et pré-industrielle qui persiste sous la forme de GHOSTS/SPECTRES : vestiges, traces et signes de modes de vie passés encore manifestes dans le présent. Au fur et à mesure que les humains remodèlent le paysage, ils oublient ce qui s'y trouvait auparavant : nos paysages nouvellement façonnés sur base des ruines des paysages précédents deviennent la nouvelle réalité. Pour y voir plus clair, nous devons (ré)apprendre à identifier et à localiser ces spectres qui renvoient vers le passé, signalent notre oubli et fournissent un substrat à partir duquel actualiser notre présent.
Notre lieu d'exploration est la plaine côtière située entre Zeebrugge (B) et Breskens (NL), et qui s'étend à l'intérieur des terres jusqu'à Bruges (B), Damme (B), Oostburg (NL) et Schoondijke (NL). Il y a environ trois mille ans, cette région était régie par des processus géologiques naturels, tels que les vagues de tempêtes et le flux et le reflux d'une mer agitée. La plaine côtière actuelle est le résultat d'une combinaison d'interventions anthropiques qui ont commencé il y a plus de mille ans, et de mouvements de marée à long terme qui ont déposé des sédiments, érodé et modifié le niveau de la mer. C'est donc un paysage de négociation permanente qui s'est formé et dont,
encore au 16è siècle, il était possible d'observer des parties disparaître sous la mer. Aujourd'hui, c'est un lieu traversé par un réseau dense d'infrastructures visant à contrôler tous les risques possibles, qui sera comparé à d'autres sites côtiers dans le cadre du projet NeRu (newruralities.eu).
Page dédiée sur le site web de la Faculté d'architecture La Cambre Horta: https://archi.ulb.be/un-urban-nature
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
UN – Urban Nature participe du perfectionnement des acquis d'apprentissage spécifiques attendus au sein des cours de Projet d'architecture, tels que repris dans la grille d'évaluation des "jurys BA3" (voir fichier téléchargeable ci-dessous) :
- Dimensionnement spatial
- Composition architecturale
- Usages
- Échelles
- Matière
- Oral
- Représentation
En outre, les étudiant·es BA3 seront invité·es à concentrer leurs travaux sur le thème du "paysage vernaculaire" et du "Tiers-paysage".
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
Prérequis
- Projet d'architecture
-
Projet d'architecture 1 – PROJ-P1300
Projet d'architecture 2 – PROJ-P2300
- Composition et représentation
-
Composition et représentation 1 : Théorie et critique d'architecture – COMM-P1303
- Moyens d'expression
-
Moyens d'expression 1 : Représentations d'architecture — COMM-P1103
Moyens d'expression 2 : Représentations d'architecture — COMM-P1203
- Autre
-
Interactions avec le milieu – ENVI-P1204
- Co-requis
-
Histoire de l'architecture 2 : Architecture - modernités – HIST-P2306
Paysage et Patrimoine – ARPA-P3101
Urbanisme et géographie urbaine — URBA-P3111
Composition et Représentation 2 – COMM-P2103
Composition et Représentation 3 – COMM-P2203
Composition et représentation 4 — COMM-P3303
Moyens d'expression 3 : Représentations d'architecture – COMM-P2303
Moyens d'expression 4 – COMM-P3103
Cours ayant celui-ci comme pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
L'unité UN – Urban Nature adopte un dispositif pédagogique d' "atelier de projet", c'est-à-dire de séances bi-hebdomadaires alternativement dédiées à des communications structurées par les enseignant·es, à des contributions d'invité·es externes, à des visites de site ou d'exposition, à des exercices brefs bien définis (séminaire de lecture, "loge" de production d'un produit bien défini au préalable, ...), discussion collectives, de séances de travail individuel et/ou de groupe, à des séances de "correction" des travaux des étudiant·es, ainsi qu'à des participations à des évènements culturels hors de l'horaire assigné aux séances de cours (conférences, ...).
Des travaux plus précis faisant l'objet d'évaluation "formatives" sont également proposés; leur objet, modalités, et échéances sont communiqués par les enseignant·es en séance.
La présentation de ces travaux face aux enseignant·es et autres étudiant·es fait l'objet d'évaluations constructives.
L'ensemble de ces activités contribue, in fine, à la production d'une proposition de transformation spatiale.
Contribution au profil d'enseignement
Les projets produits au sein de l'unité UN – Urban Nature seront l'occasion de vérifier la capacité des Bacheliers en Architecture de synthétiser les acquis suivants :
- A. Instruire une question architecturale
-
- S’appuyer sur des savoirs théoriques et des lectures exploratoires personnelles, sensibles et critiques;
- Analyser, documenter, comprendre et hiérarchiser les enjeux d’une question architecturale, urbaine, paysagère et/ou territoriale;
- Lire et décrire l’architecture, l'urbanisation, le paysage, le territoire à l’aide du vocabulaire adéquat;
- Regarder, comprendre et valoriser un contexte, physique et humain;
- Se constituer une culture architecturale, urbaine, et paysagère;
- Illustrer et questionner un projet par des exemples pertinemment identifiés dans l’histoire de l’architecture, de l’art et/ou d’autres disciplines.
- B. Élaborer une réponse spatiale située
-
- S’approprier les langages verbaux, écrits, graphiques de la composition architecturale, urbaine, territoriale et paysagère;
- Comprendre et problématiser des éléments du contexte;
- Intégrer des domaines de natures différentes (histoire, société, culture, etc.)
- Démontrer la complémentarité d’ATTITUDES (faire sens: « le Pourquoi ?») et d’APTITUDES (savoir-faire : « le Comment ? ») dans la pratique du projet;
- Savoir passer des idées aux objets;
- Apprendre à instruire une critique de l’objet conçu;
- Maîtriser les questions de dimensionnement et d’usage;
- Connaître et manipuler les éléments de la composition architecturale, urbaine, territoriale et paysagère;
- Développer un propos cohérent sur les logiques techniques et structurelles du projet;
- S’appuyer sur la prise en compte de contraintes et de valeurs (patrimoniales, culturelles, socioéconomiques, artistiques, historiques, environnementales, paysagères, ...).
- C. Interagir avec l'ensemble des acteurs
-
- Communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des réflexions, des idées autour de questions patrimoniales et paysagères et de leurs résolutions spatiales.
- Maîtriser l’ensemble des codes et moyens conventionnels de représentation graphique de l’espace architectural, urbaine, paysager et/ou territorial aux différentes échelles;
- Utiliser les outils de représentation (en 2D et en 3D) comme moyens d’exploration, d’élaboration, puis de transmission du projet;
- Développer une identité visuelle pour composer des présentations graphiques cohérentes, explicites et adaptée aux circonstances;
- Maîtriser la communication verbale pour transmettre et dialoguer dans le cadre d’une production architecturale, patrimoniale et paysagère
- faisant preuve de posture réflexive, d'ouverture, d'initiative,
- assumant une responsabilité citoyenne,
- développant l'autonomie de réflexion et d'action indispensable aux confrontations et aux collaborations,
- intégrant la responsabilité éthique.
Références, bibliographie et lectures recommandées
- Lecture recommandées
-
- Allaert, G. Leinfelder, H., Vanden Abeele, P., Verhoestraete, D. (2005). Water (management) as a decisive factor in the land use planning of agriculture in an urbanising context. European Regional Science Association, ERSA conference papers. LINK
- Allaert, G., Leinfelder, H., Vanden Abeele, P., & Verhoestraete, D. (2006). Hoe boeren agrarische ondernemers werden: naar een ruimtelijke planning van agro-industriële landschappen op maat van aanwezige dynamieken. RUIMTE EN PLANNING, 26(4), 10–23. LINK
- Ashworth, G.J. (1992). Planning the Coastal Zone in Belgium. In: Dutt, A.K., Costa, F.J. (eds) Perspectives on Planning and Urban Development in Belgium. The GeoJournal Library, vol 22. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2577-4_6
- Berger, J. (1979). Pig earth, New York – London, Pantheon Books – Writers and Readers Publishing Cooperative
- Bert Pijnenburg & Menno J. Van Duin (1990) The Zeebrugge ferry disaster. Elements of a communication and information processes scenario, CONTEMPORARY CRISES 14, 321–349. https://doi.org/10.1007/BF00728504
- Charlier, R.H., Charlier, C.C. (2018). Venice-of-the-North’s Ups and Downs: A Brief History of the Port City of Bruges, Belgium. In: Finkl, C., Makowski, C. (eds) Diversity in Coastal Marine Sciences. Coastal Research Library, vol 23. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57577-3_36
- Cividino, H. (2012) Architectures agricoles : la modernisation des fermes, 1945-1999. Rennes: Presses universitaires de Rennes. [en bibliothèque]
- Cividino, H. (2018). Nouvelles architectures agricoles : nouvelles agricultures. Antony : Editions Le Moniteur. [en bibliothèque]
- Clément, G. (c2004, 2022). Manifesto of the Third Landscape, TEH Series on new imaginaries #3, Trans Europe Halles. LINK
- ing, N., Hein, C. (eds.) (2020) The Urbanisation of the Sea; nai010 publishers, Rotterdam.
- Debaise, D. & Stengers, I. (2016). L’insistance des possibles: Pour un pragmatisme spéculatif. Multitudes, 65, 82-89. https://doi.org/10.3917/mult.065.0082
- Douvere, F. (2005). Socio-Economic Value of the Human Activities in the Marine Environment: The Belgian Case. In: Maes, F. (eds) Marine Resource Damage Assessment. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_10
- Everaert, J., Stienen, E.W.M. Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Biodivers Conserv 16, 3345–3359 (2007). https://doi.org/10.1007/s10531-006-9082-1
- Koolhaas, R.; Bantal, S. 2020. Countryside: A Report (exhibition catalogue: Guggenheim Museum). Taschen. [en bibliothèque]
- Krzysztofowicz, M., Rudkin, J., Winthagen, V. and Bock, A., (2020) Farmers of the future, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://doi.org/10.2760/680650
- Gan, E. Tsing, A., Swanson, H., Bubandt, N. (2017) “Introduction: Haunted Landscapes of the Anthropocene”, in ID. (eds.) Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene, University of Minnesota Press
- Lannoy, D. (1974) . Het landschapsvormende proces van onze kustvlakte, CNOCKE IS HIER, 03, 19-23. LINK
- Lescrauwaet, AK., Fockedey, N., Debergh, H. et al. Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries. Rev Fish Biol Fisheries 23, 229–243 (2013). https://doi.org/10.1007/s11160-012-9287-1
- Library University, Uyttenhoven, P. (2015). Recollecting Landscapes [website]. http://www.recollectinglandscapes.be/en-general
- Lovelock, J., Margulis, L. (1972) Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the gaia hypothesis. TELLUS, 26: 2-10. https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1974.tb01946.x
- Marot, S. 2019. Taking the country's side : agriculture and architecture (exhibition catalogue), Lisbon Architecture Triennale. [en bibliothèque]
- Stouthamer, E., Cohen, K. (2020). Berendsen - Fysische geografie van Nederland - De vorming van het land. Perspectief Uitgevers.
- Uyttenhoven, P., Vanbelleghem, D., Van Bouwel, I., Nottenboom, B., Debergh, R., Willequet, B. (2018). Recollecting Landscapes - Rephotography, Memory and Transformation 1904–1980-2004-2014. Roma Publications.
- Vanneste, P.; Hooft, E.; Callaert, G. (2005) Heist geschiedenis, [online], Inventaris Onroerend Erfgoed. https://id.erfgoed.net/themas/14394
- Verdier, M. 2012. "Architectes et urbanistes en campagne... Réinventer un urbanisme rural?", Cité de l'Architecture et du Patrimoine, vidéo en ligne, https://dai.ly/x11sd0w
- Verhulst, A. (2000) Historische ontwikkeling van het kustlandschap, VLAANDEREN. KUNSTTIJDSCHRIFT 49, 135. LINK
- Wintein, W. (2003a). Ontstaan en evolutie van het landschap in de Zwinstreek (DEEL 1), ROND DE POLDERTORENS 1, 3-36, LINK
- Wintein, W. (2003b). Ontstaan en evolutie van het landschap in de Zwinstreek (DEEL 1), ROND DE POLDERTORENS 1, 18-36. LINK
- Woods, M. (2010) Rural. New York: Routledge. [en bibliothèque]
Autres renseignements
Informations complémentaires
- Activités obligatoires:
-
Séjour sur site du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2023 inclus (auberge de jeunesse de Duzele, entre Bruges et Zeebrugge). Logement et couvert pris en charge par le projet NeRu–New Ruralities, frais de déplacement à charge des étudiant·es.
- Langue d'enseignement:
-
Afin de permettre aux étudiant·es n'ayant pas l'opportunité de participer à un programme de mobilité internationale, à celles et ceux désirant s'y préparer, ou à celles et ceux désireux et désireuses d'améliorer leurs compétences linguistiques, les activités de l'unité UN – Urban Nature sont dispensées principalement en anglais. Toutefois, le français pourra être utilisé comme seconde langue au besoin.
Aucun niveau de langue anglaise n'est requis pour la participation à l'unité UN – Urban Nature, mais un niveau C1 de la grille d'auto-évaluation du passeport européen des langues est recommandé (voir la grille).
En complément, afin de faciliter les échanges avec et l'intégration des étudiant·es provenant de l'étranger, l'espagnol (Nadia Casabella) et l'italien (Axel Fisher) peuvent être utilisés. - Équipe pédagogique:
-
Q1= 1er quadrimestre: Nadia Casabella & François Vliebergh
Q2= 2ème quadrimestre: Nadia Casabella & Axel Fisher
Contacts
- Q1: Écrire un mail à Nadia Casabella ET François Vliebergh
- Q2: Écrire un mail à Nadia Casabella ET Axel Fisher
Campus
Solbosch, Flagey
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Projet
Projet
Deux modes d’évaluation sont prévus :
- Une évaluation "formative" continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e (avec remises intermédiaires, aux dates convenues, de l’état d’avancement des recherches, et projets de groupe et individuels) et sa participation active et engagée durant les séances d'atelier. Ces évaluations formatives seront communiquées à l’étudiant·e tout au long de l’année, à l’issue des moments-clé, avec une synthèse de celles-ci à l’issue du premier quadrimestre. Ces notes permettront aux étudiant·es de se "situer" au cours de chaque quadrimestre et de l'année. Les enseignant·es se réservent le droit de surévaluer ou sous-évalur les notes formatives pour des raisons pédagogiques, principalement pour motiver les étudiant·es.
- Des évaluations "certificatives" à l’issue de chacun des quadrimestres.
Lors de certains de ces moments d'évaluation, les enseignant·es constituent un "jury (d'atelier)", composé de personnalités invité·es (autres enseignatn·s de la formation, figures du monde professionnel, représentant·es d'administrations publiques, responsables politiques, ...). Les étudiant·es présenteront leurs travaux à ce jury, qui les évaluera. Ce jury est distinct du jury de délibération, composé lui uniquement d'enseignant·es de la faculté, et s'exprimant sur l'ensemble du parcours annuel et de cycle des étudiant·es. Le "jury (d'atelier)" vise à confronter l'étudiant·e à l'appréciation de ses futur·es pairs et client·es, et à objectiver l'acquisition et la pertinence professionnelle et sociétale des acquis d'apprentissage.
Les travaux des étudiant·es de B.Arch-3 et de M.Arch-2 (années diplômantes) devront par ailleurs répondre aux critères d'évaluation communs aux ateliers de projet d'architecture de la faculté.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Les évaluation "formatives" ne contribuent pas à la construction de la note. Elles ne peuvent en aucun cas être considérée comme un indicateur incontestable de la note finale.
La note de l’UE est construite exclusivement sur les évaluations "certificatives", qui considéreront la progression et la capacité de synthèse des acquis d'apprentissage des étudiant·es.
Les évaluations certificatives sont pondérées comme suit :
- Évaluation certificative du Q1: 40 % de la note finale
-
- Travail durant le Q1 en atelier : 40 % (note attribuée par les enseignant·es en considération des compétences cognitives ET comportementales démontrées par l'étudiant·e);
Un "jury d'atelier" pourra être organisé en fin du Q1 et constituera une évaluation "formative" dont les enseignant·es tiendront compte dans la composition de la note "certificative" du quadrimestre.
- Travail durant le Q1 en atelier : 40 % (note attribuée par les enseignant·es en considération des compétences cognitives ET comportementales démontrées par l'étudiant·e);
- Évaluation certificative du Q2 : 60 % de la note finale:
-
- Travail durant le Q2 en atelier : 30 % (note attribuée par les enseignant·es en considération des compétences cognitives ET comportementales démontrées par l'étudiant·e);
- SIP: 5%
- Jury final : 25 % (note attribuée par les enseignant·es et les membres du "jury d'atelier" sur base de la grille d'évaluation de jury BA3)
Les étudiant·es B.Arch-3 ne fréquentant que le Q2 se verront attribuer la note du Q2 comme note finale, ainsi pondérée:- Travail durant le Q2 en atelier : 57,5 % de la note finale (note attribuée par les enseignant·es en considération des compétences cognitives ET comportementales démontrées par l'étudiant·e);
- SIP: 2,5%
- Jury final : 40 % de la note finale (note attribuée par les enseignant·es et les membres du "jury d'atelier" sur base de la grille d'évaluation de jury BA3)
Les compétences cognitives évaluées sont celles reprises au Profil d'enseignement "Bachelier en architecture" sous les titres:
- A. Instruire une question architecturale;
- B. Élaborer une réponse spatiale située;
- C. Interagir avec l'ensemble des acteurs.
Les compétences comportementales sont – outre la régularité, la participation, la progression, le respect des échéances et des instructions, le soin et l'attitude constructive et respectueuse du collectif – celles visées par le Profil d’enseignement du Bachelier en Architecture de l’ULB, en matière de développement d’étudiants-acteurs capables de poser des choix engagés.
Langue(s) d'évaluation
- anglais
- partiellement en anglais
- (éventuellement français, Espagnol, Italien, Galicien )