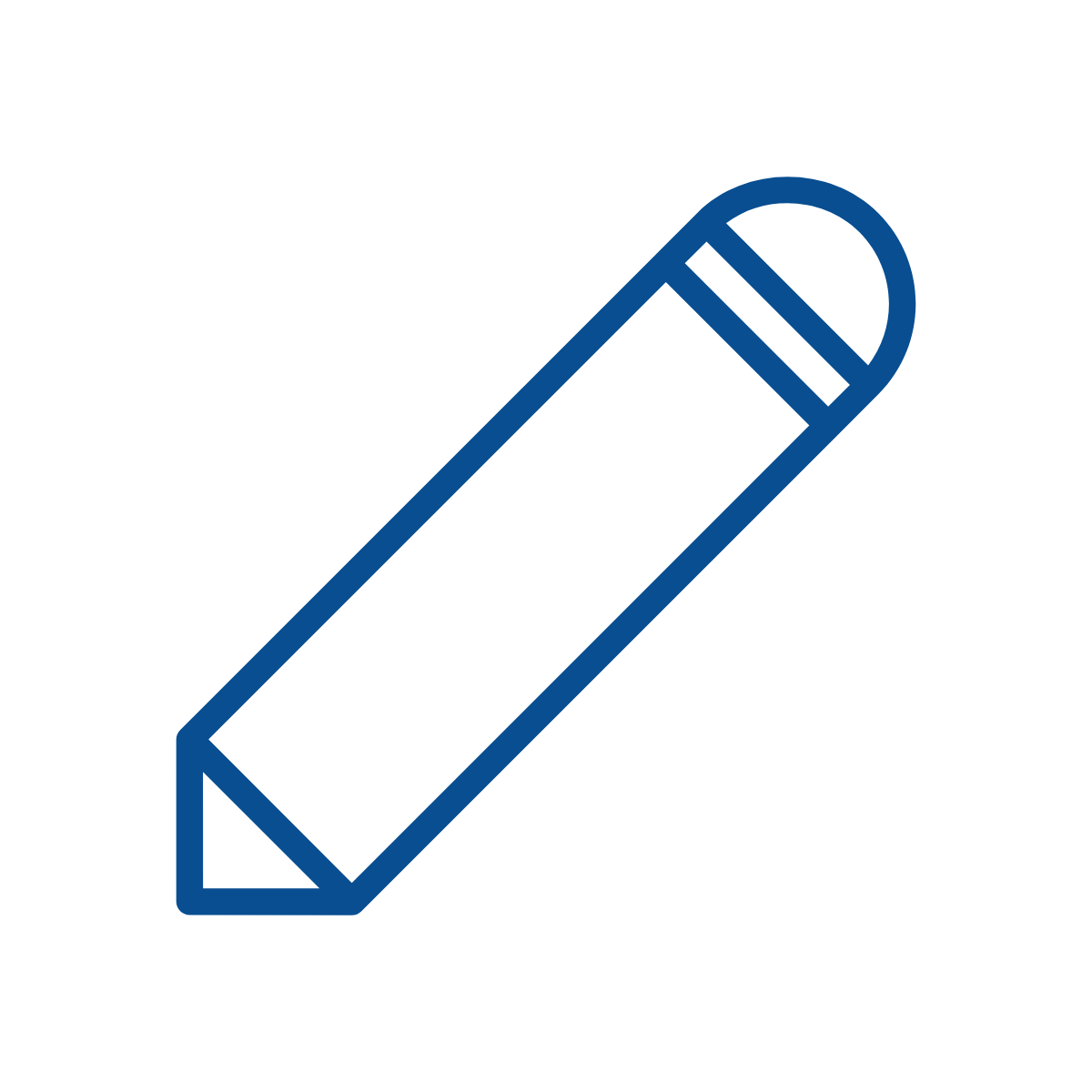-
Partager cette page
Paysage et Patrimoine
Titulaire(s) du cours
Yves Robert (Coordonnateur) et Virginie PigeonCrédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
- Théorie des patrimoines (Yves Robert, coordonnateur – 2,5 ECTS)
- Théorie du paysage (Virginie Pigeon – 2,5 ECTS)
La présence d'un cours traitant de la Théorie de la conservation et de la restauration des patrimoines au sein du cursus architectural d’une faculté d’architecture, traduit la nécessité de sensibiliser de futur.e.s acteur.e.s de l'aménagement du territoire aux enjeux sociétaux engendrés par les questions patrimoniales. Le cours a comme ambition de faire prendre conscience aux étudiant.e.s en architecture de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et critique face aux choix posés en matière d'héritage culturel, afin qu'ils/elles puissent faire face aux enjeux culturels auxquels la société attend qu'ils/elles répondent à l’occasion de leur activité professionnelle.
Le cours de « Théorie du paysage » vise à introduire les étudiant.e.s à la pluralité des théories du paysage, à leurs principaux imaginaires formels et répertoires conceptuels; et replace ces théories dans le cadre des pratiques du projet de paysage historique et contemporain.
ESPACE UV ARPA-P3101
- « Théorie des patrimoines » – Plan du cours
-
La première partie du cours se propose d’exposer les principes de la « grammaire » patrimoniale en analysant les mécanismes de réflexion en matière de conservation et restauration établis au cours des XIXe, XXe et XIXe siècles, dont les argumentaires se fondent sur les notions équivoques de « monuments historiques », de « valeur d’âge », de restauration « dans le style », « critique », ou encore d’ « authenticité » chez des personnalités comme Viollet-le-Duc, Ruskin, Boito, Giovannoni, Benjamin, Brandi, Jeudy, etc.
La seconde partie du cours s’attache à analyser les principes exposés dans les chartes, conventions et autres recommandations (ICOMOS, UNESCO, etc.) en matière de conservation et restauration de l’architecture.
La troisième partie du cours correspond à divers focus sur des projets et enjeux patrimoniaux au sein du contexte belge et international.
- « Théorie du paysage » – Plan du cours
-
Le cours se déploie sur une dizaines de thèmes cherchant à la fois à restituer l’épaisseur de la notion de paysage et la manière dont cette polysémie est un moteur pour le projet de paysage.Le cours s’appuie sur les textes de Jean-Marc Besse, Alain Roger, Augustin Berque, John Brinckerhoff Jackson. Ces lectures sont conseillées mais ce sont les éléments transmis oralement lors de séances en auditoire qui sont la base du cours sur laquelle l’étudiant.e sera interrogé.e.
Les thématiques abordées en séances sont :
Introduction et polysémie de la notion
Le paysage comme représentation culturelle et sociale
Le paysage, territoire produit par les sociétés dans leur histoire
Le paysage en tant q qu’environnement, le socle matériel et vivant des sociétés humaines
Le paysage comme espace d'expériences sensibles
Composition et espaces du paysagisme contemporain
Le paysagisme américain
Approches complémentaires à préciser en cours
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
À l’issue de cette unité d’enseignement, un.e étudiant.e sera capable :
« Théorie des patrimoines »- De développer un point de vue critique sur des interventions (restauration, reconversion, etc.) à caractère patrimonial sur des monuments, bâtiments, sites et autres biens immobiliers.
« Théorie du paysage »
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
Cours pré-requis
- HIST-P1306 – Histoire de l'architecture (Marianne PUTTEMANS, 5 crédits ECTS)
- HIST-P2306 – Architecture - modernités (Pablo LHOAS, 5 crédits ECTS)
- ENVI-P1204 — Interactions avec le milieu (Suzanne GIOVANNINI et Bernard DEPREZ, 5 crédits ECTS)
Cours pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
« Théorie des patrimoines »
Cours ex cathedra dispensé à l’aide de « PowerPoint ».
« Théorie du paysage »
Présentiel : cours ex cathedra dispensé à l’aide de « PowerPoint ».
Références, bibliographie et lectures recommandées
Sources principales sur la base desquelles l’UE a été élaborée
« Théorie des patrimoines »
- BABELON Jean-Pierre, CHASTEL, André, La notion de patrimoine, Paris, Éditions Liana Levi, 1994, 141 p.
- BOITO, Camillo, Conserver ou restaurer, les dilemmes du patrimoine (traduit de l'italien par Jean-Marc Mandosio), Besançon, Les Éditions de l'Imprimeur, 2000, 109 p.
- BRANDI, Cesare, Théorie de la restauration, (traduit de l'italien par Colette Déroche), (introduction par Georges Brunel), Paris, Éditions des Monuments nationaux / Monum, Éditions du patrimoine, (1ère édition en 1963), 2001, 207 p.
- CHOAY, Françoise, L'Allégorie du Patrimoine, Paris, Éditions du Seuil, 1992, 272 p.
- GIOVANNONI, Gustavo, L’urbanisme face aux villes anciennes, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 349 p. L’ouvrage fut publié originellement en italien en 1931 sous le titre Vecchie città ed edilizia nuova.
- GRAVARI-BARBAS, Maria (sous la direction de), Habiter le patrimoine, enjeux, approches, vécu, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, 624 p.
- HEINICH, Nathalie, La fabrique du patrimoine, « de la cathédrale à la petite cuillère », Paris, Editions de la Maison des sciences de l’Homme, 2009, 286 p.
- JEUDY, Henri-Pierre, La machinerie patrimoniale, Paris, Éditions Sens & Tonka, 2001, 127 p.
- RIEGL Aloïs, Le culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, (introduction de Françoise Choay), Paris, Éditions du Seuil, 1984, 122 p. (L’ouvrage est paru à Vienne en 1903 sous le titre original de Der Moderne Denkmalkultus).
« Théorie du paysage »
- Berque, Augustin. Les Raisons Du Paysage: De La Chine Antique Aux Environnements de Synthèse. Editions Hazan, 1995.
- Besse, Jean-Marc. Le Goût Du Monde. Exercices de paysage. Actes Sud/ENSP, 2009.
- Besse, Jean-Marc. La nécessité du paysage. Parenthèses, 2018.
- John Brinckerhoff Jackson. A La Découverte Du Paysage Vernaculaire. Actes Sud/ENSP, 2003.
Support(s) de cours
- Syllabus
Contribution au profil d'enseignement
Parmi les compétences visées par le Profil d’enseignement du Bachelier en Architecture de l’ULB, cette unité d’enseignement contribue aux compétences suivantes :
- INSTRUIRE UNE QUESTION ARCHITECTURALE
- S’appuyer sur des savoirs théoriques et des lectures exploratoires personnelles, sensibles et critiques
- Analyser, documenter, comprendre et hiérarchiser les enjeux d’une question patrimoniale et paysagère
- Lire et décrire l’architecture (dans sa dimension patrimoniale et paysagère) à l’aide du vocabulaire adéquat.
- Regarder, comprendre et valoriser un contexte, physique et humain
- Se constituer une culture architecturale (patrimoniale et paysagère)
- Illustrer et questionner un projet par des exemples pertinemment identifiés dans l’histoire de l’architecture, de l’art et/ou d’autres disciplines (patrimoine et paysage).
- ÉLABORER UNE RÉPONSE SPATIALE SITUÉE
- S’approprier les langages verbaux, écrits, graphiques de la composition patrimoniale et paysagère
- Comprendre et problématiser des éléments du contexte (patrimonial et paysager).
- Intégrer des domaines de natures différentes (histoire, société, culture, etc.)
- Démontrer la complémentarité d’ATTITUDES (faire sens: « le Pourquoi ?») et d’APTITUDES (savoirfaire : « le Comment ? ») dans la pratique du projet patrimonial et paysager.
- Savoir passer des idées aux objets.
- Apprendre à instruire une critique de l’objet patrimonial et paysager
- Maîtriser les questions de dimensionnement et d’usage.
- Connaître et manipuler les éléments de la composition patrimoniale et paysagère
- S’appuyer sur la prise en compte de contraintes et de valeurs (patrimoniales, culturelles, socioéconomiques, artistiques, historiques, environnementales, paysagères, ...)
- INTERAGIR AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS
- Communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des réflexions, des idées autour de questions patrimoniales et paysagères et de leurs résolutions spatiales.
- Maîtriser la communication verbale pour transmettre et dialoguer dans le cadre d’une production architecturale, patrimoniale et paysagère
- faisant preuve de posture réflexive, d'ouverture, d'initiative,
- assumant une responsabilité citoyenne,
- développant l'autonomie de réflexion et d'action indispensable aux confrontations et aux collaborations,
- intégrant la responsabilité éthique.
Autres renseignements
Informations complémentaires
Des aménagements spécifiques sont prévus par l’ULB pour les Étudiant.e.s à besoins spécifiques (EBS), comme :
- ESH : Étudiants en situation de handicap, souffrant d'une maladie invalidante, d'une déficience avérée, ou de trouble d'apprentissage
- SHN : Étudiants Sportifs de haut niveau
- EE : Étudiants Entrepreneurs
- AHN : Étudiants Artistes de haut niveau
- Étudiants incarcérés
- Étudiantes enceintes, (futur.es) jeunes parents
Pour en savoir plus :Accompagnement des étudiant·es à besoins spécifiques
N’oubliez pas de consulter régulièrement les bons tuyaux du SAA – Service d’accompagnement aux apprentissages, ULB:
https://uv.ulb.ac.be/course/view.php?id=82423
Contacts
« Théorie des patrimoines »: yves.robert@ulb.be
« Théorie du paysage »: virginie.pigeon@ulb.be
Campus
Flagey, Solbosch
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Examen écrit
Examen écrit
- Question fermée à Choix Multiple (QCM)
- Question ouverte à réponse courte
- Question visuelle
- Question fermée Vrai ou Faux (V/F)
- Question ouverte à texte à trous
- Question fermée à Réponses Multiples (QRM)
- Question ouverte à développement long
Chaque partie de l’unité d’enseignement (« Théorie des patrimoines », Yves ROBERT / « Théorie du paysage », Axel FISHER) fait l’objet d’une évaluation distincte.
« Théorie des patrimoines »: L’examen écrit prend la forme d’un QCM et de très courtes réponses à rédiger (quelques mots) ou encore de mentions à biffer.
« Théorie du paysage »: L’examen écrit prend la forme d’un QCM et de très courtes réponses à rédiger (quelques mots) ou encore de mentions à biffer.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Note globale = note partielle la plus basse en cas d’échec si l'une des deux notes est égale ou inférieure à 08/20 dans l'une des deux activités (patrimoine ou paysage), sinon moyenne arithmétique simple des cotes partielles de chaque activité (50% + 50%).
Théorie des patrimoines: Report de note de réussite partielle automatique d’une session à l’autre (janvier > août) et d'une année à l'autre.
Théorie du paysage: Report de note de réussite partielle automatique d’une session à l’autre (janvier > août) mais pas d'une année à l'autre.
Langue(s) d'évaluation
- français