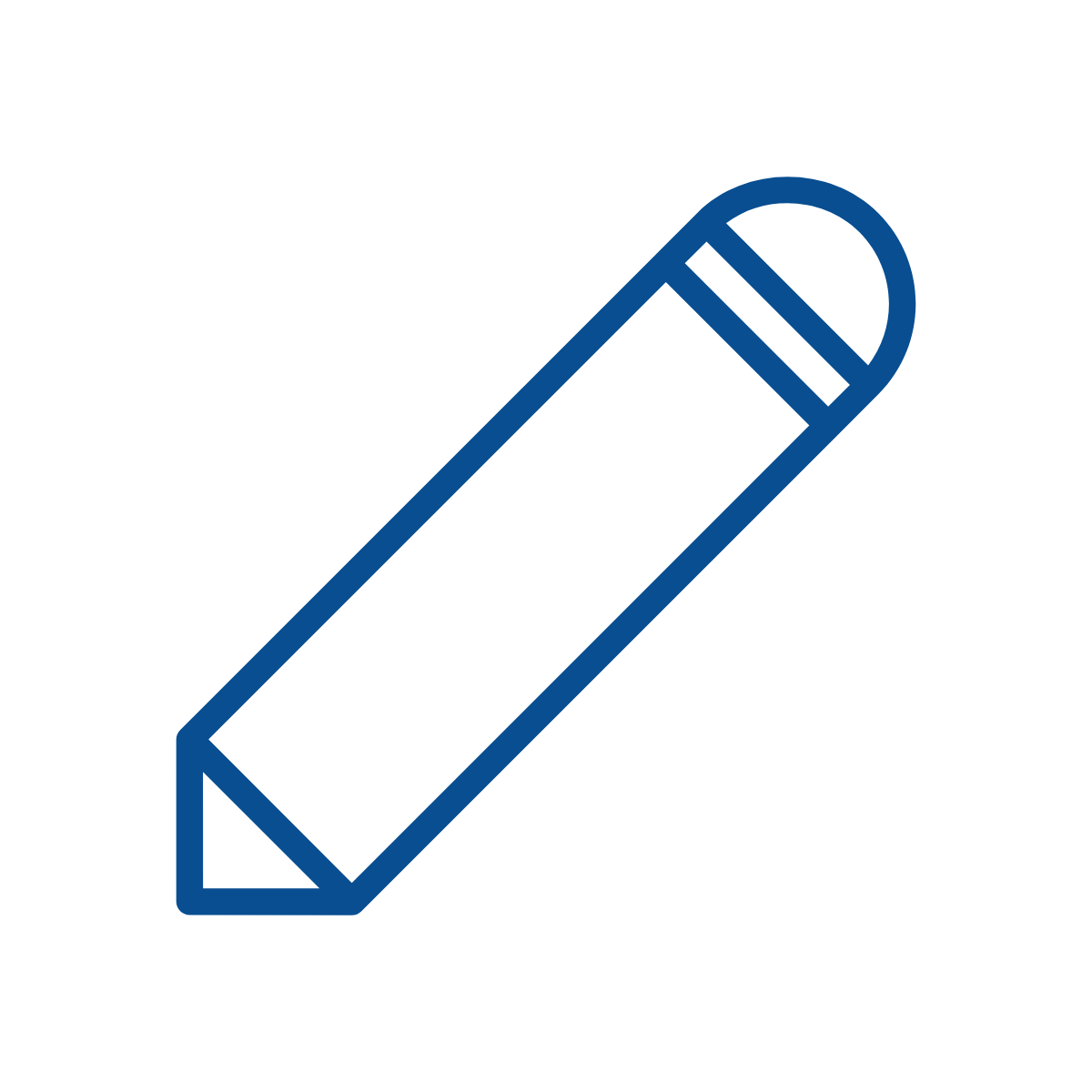Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Elisavet STAMATAKI - Faculté des Sciences
Publié le 3 septembre 2025
– Mis à jour le 3 septembre 2025
Soutenance publique de thèse (et séminaire de cotutelle) en vue de l'obtention du grade de Doctorat en Sciences
Titre de la thèse:"Death and Fire: Investigating changes and specialisation in cremation practices in Belgium through time and space "
Résumé:
De la fin de l’Âge du Bronze à l’époque Romaine, la crémation constituait le rite funéraire dominant en Belgique. Toutefois, peu d’informations existent sur les conditions dans lesquelles ce rite était exécuté, ainsi que sur les acteurs de ce rite. Cette thèse se penche sur les transitions diachroniques et les variations régionales existant dans les pratiques de crémation en Belgique, avec une attention particulière sur le rôle et l’expertise technique du crémateur, la personne responsable de la construction et de l’entretien du bûcher. En faisant recours à l’archéologie expérimentale et à une stratégie d’échantillonnage et d’analyses multiples, cette étude propose une nouvelle méthode pour comprendre les pratiques funéraires des populations du passé.
Ce travail de thèse applique, sur des échantillons expérimentaux et archéologiques, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR-ATR), des analyses isotopiques stables du carbone et de l’oxygène (δ13C, δ18O), ainsi que des rapports isotopiques et les concentrations de strontium (87Sr/86Sr, δ88Sr, [Sr]). Des crémations expérimentales, réalisées en laboratoire et en conditions extérieures, ont été réalisées afin d’évaluer les effets des conditions de combustion sur la structure et la composition chimique du squelette/des os. Des éléments tels que la température du bûcher, la position du corps, la saisonnalité, le type de combustible, et la présence ou non de vêtements ou de chaussures sont autant de paramètres qui ont été étudiés au cours de ces crémations expérimentales. Ces dernières soulignent l’importance de la réplicabilité et du contrôle de ces paramètres, afin de comprendre et d’interpréter au mieux les données qui en ressortent.
Afin de comprendre les traditions régionales et l’impact de l’arrivée de la culture Romaine sur celles-ci, des études de cas ont été réalisées dans les bassins de l’Escaut et de la Meuse. Aux âges du Bronze et du Fer, les résultats des analyses ont montré des différences significatives dans les conditions de crémations, reflétant probablement des traditions culturelles distinctes (Atlantique vs. Continentale par exemple). A la période Romaine, les crémations deviennent plus standardisées. Toutefois, des sites se situant à l’interface chronologique entre la fin de l’Âge du Fer et le début de la période Romaine, tel que Fouches, montrent des variations, témoignant de la conservation des pratiques de l’époque précédente. Les analyses isotopiques du strontium ont montré en parallèle une transition
dans les pratiques alimentaires, avec une hausse de la consommation de sel chez des individus de la période Romaine, tandis que des sites de transition comme Fouches montrent une signal isotopique mixte, similaire à celui observé dans des sites des âges du Bronze et du Fer.
Cette thèse illustre l’utilité d’une double approche expérimentale et multi-analytique pour l’étude des restes issus de crémations. En reconstruisant les continuités culturelles et les transformations des pratiques de crémation, ce travail propose une nouvelle compréhension des pratiques funéraires du Nord-Ouest de l’Europe, ainsi qu’une méthode reproductible pour l’étude des pratiques de crémation dans des contextes géographiques et chronologiques variés.
Résumé:
De la fin de l’Âge du Bronze à l’époque Romaine, la crémation constituait le rite funéraire dominant en Belgique. Toutefois, peu d’informations existent sur les conditions dans lesquelles ce rite était exécuté, ainsi que sur les acteurs de ce rite. Cette thèse se penche sur les transitions diachroniques et les variations régionales existant dans les pratiques de crémation en Belgique, avec une attention particulière sur le rôle et l’expertise technique du crémateur, la personne responsable de la construction et de l’entretien du bûcher. En faisant recours à l’archéologie expérimentale et à une stratégie d’échantillonnage et d’analyses multiples, cette étude propose une nouvelle méthode pour comprendre les pratiques funéraires des populations du passé.
Ce travail de thèse applique, sur des échantillons expérimentaux et archéologiques, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR-ATR), des analyses isotopiques stables du carbone et de l’oxygène (δ13C, δ18O), ainsi que des rapports isotopiques et les concentrations de strontium (87Sr/86Sr, δ88Sr, [Sr]). Des crémations expérimentales, réalisées en laboratoire et en conditions extérieures, ont été réalisées afin d’évaluer les effets des conditions de combustion sur la structure et la composition chimique du squelette/des os. Des éléments tels que la température du bûcher, la position du corps, la saisonnalité, le type de combustible, et la présence ou non de vêtements ou de chaussures sont autant de paramètres qui ont été étudiés au cours de ces crémations expérimentales. Ces dernières soulignent l’importance de la réplicabilité et du contrôle de ces paramètres, afin de comprendre et d’interpréter au mieux les données qui en ressortent.
Afin de comprendre les traditions régionales et l’impact de l’arrivée de la culture Romaine sur celles-ci, des études de cas ont été réalisées dans les bassins de l’Escaut et de la Meuse. Aux âges du Bronze et du Fer, les résultats des analyses ont montré des différences significatives dans les conditions de crémations, reflétant probablement des traditions culturelles distinctes (Atlantique vs. Continentale par exemple). A la période Romaine, les crémations deviennent plus standardisées. Toutefois, des sites se situant à l’interface chronologique entre la fin de l’Âge du Fer et le début de la période Romaine, tel que Fouches, montrent des variations, témoignant de la conservation des pratiques de l’époque précédente. Les analyses isotopiques du strontium ont montré en parallèle une transition
dans les pratiques alimentaires, avec une hausse de la consommation de sel chez des individus de la période Romaine, tandis que des sites de transition comme Fouches montrent une signal isotopique mixte, similaire à celui observé dans des sites des âges du Bronze et du Fer.
Cette thèse illustre l’utilité d’une double approche expérimentale et multi-analytique pour l’étude des restes issus de crémations. En reconstruisant les continuités culturelles et les transformations des pratiques de crémation, ce travail propose une nouvelle compréhension des pratiques funéraires du Nord-Ouest de l’Europe, ainsi qu’une méthode reproductible pour l’étude des pratiques de crémation dans des contextes géographiques et chronologiques variés.
Documents à télécharger
- Stamataki_Public Seminar.pdf PDF, 170 Ko