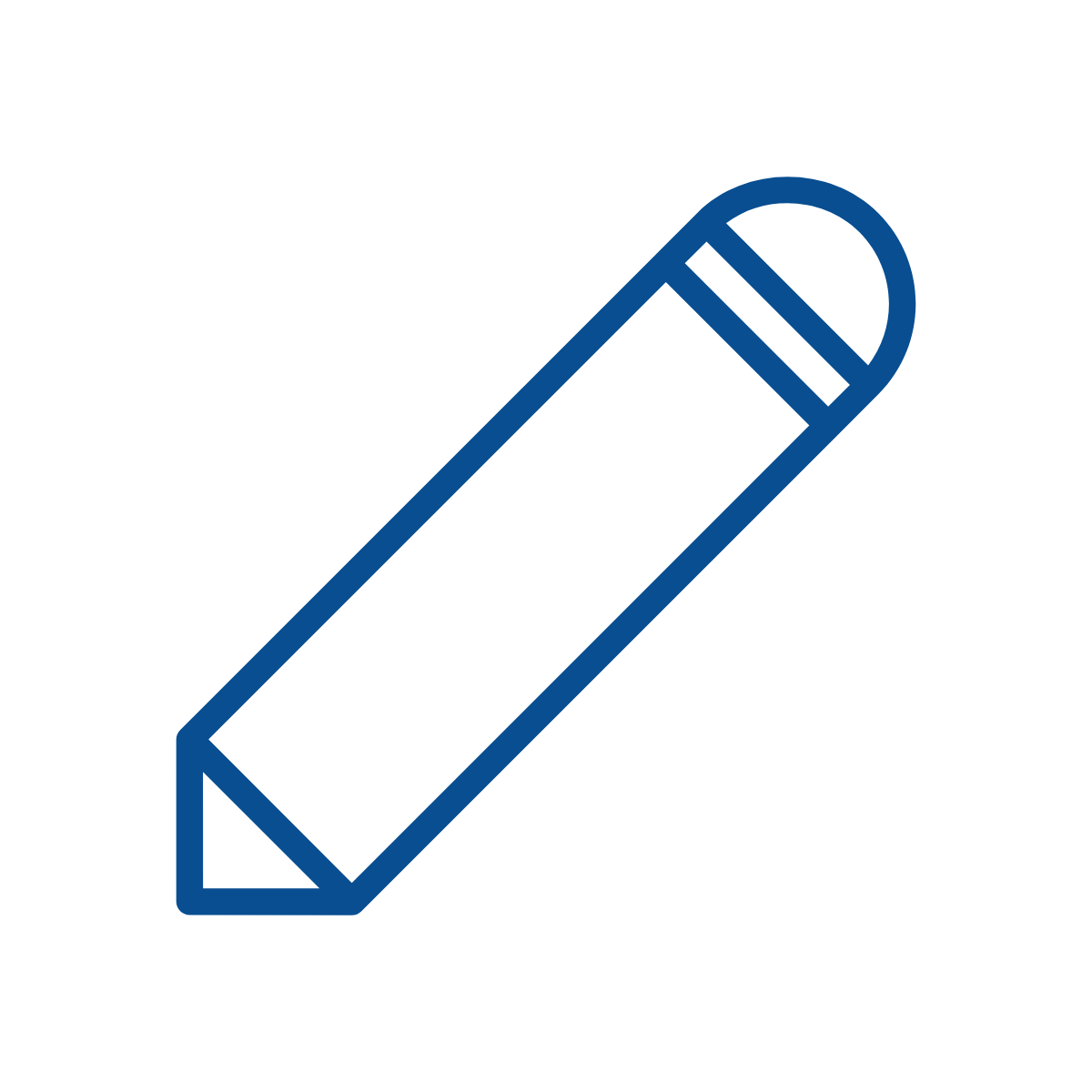-
Partager cette page
Théorie du travail social
Titulaire(s) du cours
Pierre Brasseur (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Ce cours propose une approche théorique du travail social en explorant ses fondements conceptuels, ses évolutions historiques et ses enjeux contemporains. Il retrace l'émergence du travail social de la charité traditionnelle à l'institutionnalisation des professions sociales, examine les différentes théories sociologiques et paradigmes d'intervention, analyse les concepts centraux comme l'exclusion sociale, la vulnérabilité, l'empowerment et la participation, et aborde les transformations contemporaines du secteur face aux défis de la précarisation et de la digitalisation. Les questions d'éthique, de déontologie et de professionnalisation complètent cette analyse critique des enjeux actuels du travail social.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques) :
Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de :
-
Identifier les fondements historiques et théoriques du travail social
-
Maîtriser les concepts clés du travail social contemporain
-
Analyser les enjeux actuels du secteur social
-
Appliquer une approche critique aux pratiques professionnelles
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Cours magistral
Support(s) de cours
- Syllabus
- Université virtuelle
Autres renseignements
Contacts
Par email: pierre.brasseur@ulb.be
Campus
Charleroi Ville Haute
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Examen écrit
Examen écrit
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Langue(s) d'évaluation
- français