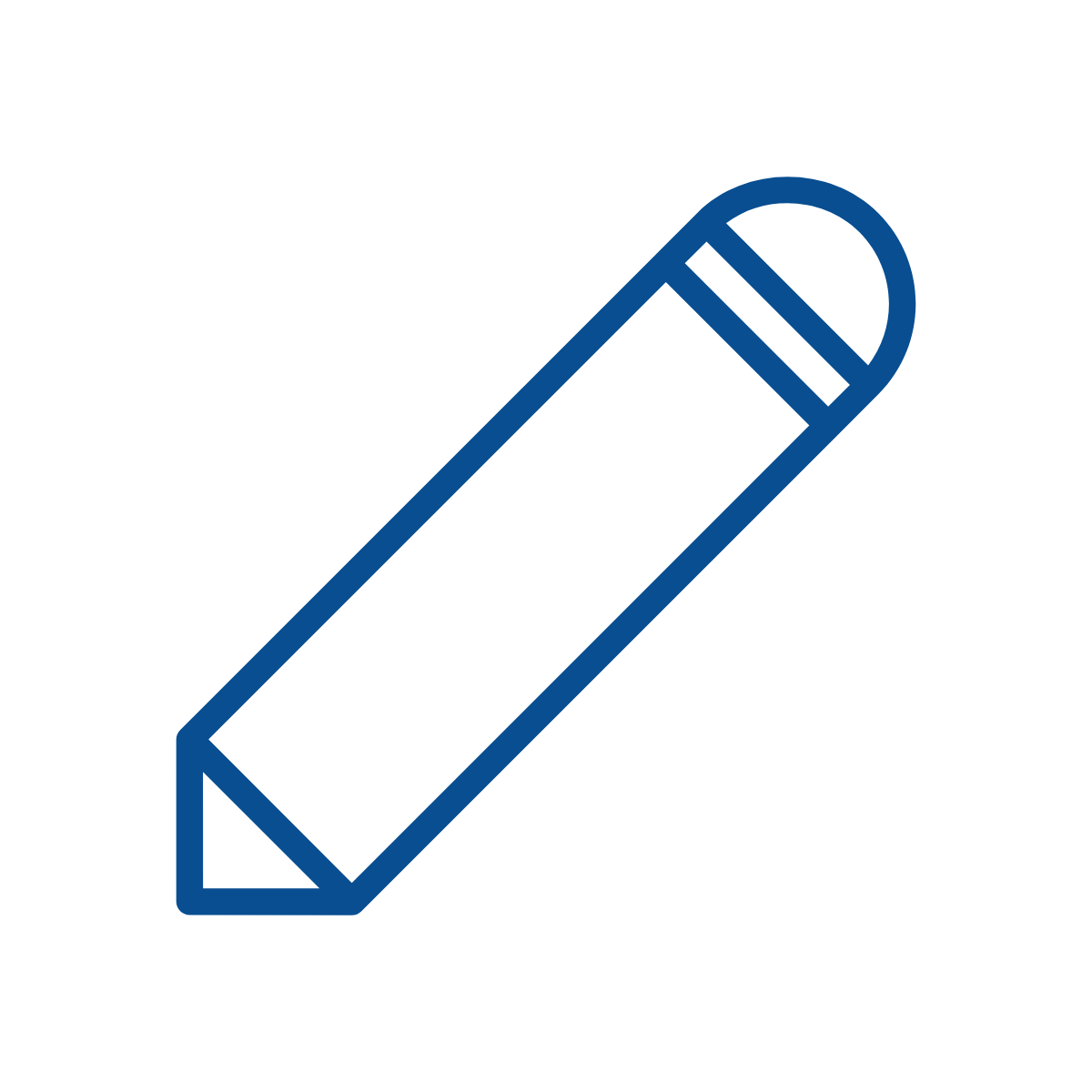-
Partager cette page
Conception énergétique des bâtiments et équipements HVAC
Titulaire(s) du cours
Benoit QUEVRIN (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
erratum (26/9/25) : ventilation des heures de cours : 48h théorie, 12h de travaux pratiques.
Le cours CNST-P2302 (60h) est donné sur les Q1 et Q2 et comprend 40 h de cours et 20h de Travaux pratiques (cette répartition est susceptible d'être modifée sensiblement en fonction des besoins de l'enseignant ou des étudiant.es). Il est dédié à comprendre les échanges thermiques du bâtiment, de manière à pouvoir concevoir un projet en anticipant ses impacts sur le confort et l'énergie et en pouvant les optimiser.
Les étudiants seront également soutenus par les assistants Julie Pereira et Julien Thirifays qui assureront essentiellement les TPs et exercices.
Le syllabus (2025) en construction s'organise en 7 chapitres :
- Introduction et contexte
(enjeux énergétiques, rôle du bâtiment, attentes sociétales, historique, cadre européen/PEB)
- Principes physiques de l’énergie et de la chaleur
(énergie, chaleur, transferts, humidité, inertie)
- Comportement énergétique de l’enveloppe
(parois, fenêtres, ponts thermiques, flux d’air, apports solaires, stockage)
- Besoins énergétiques du bâtiment
(chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, indicateurs BNC/CEP)
- Confort et bien-être
(requestionner la notion de confort, méthodes d'analyse)
- Systèmes énergétiques : consommation, production et gestion
(chauffage, climatisation, ventilation, PAC, PV, stockage, régulation, monitoring)
- Enjeux environnementaux et résilience climatique
(ACV, carbone, taxonomie, NZEB/ZEB, adaptation au climat futur, résilience urbaine)
Les syllabus du professeur précédent Bernard Deprez restent à disposition et seront utilisés pour toutes les parties que le syllabus 2025 en cours de construction n'aborde pas.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Le cours étudie les éléments qui constituent la compétence énergétique des bâtiments pour permettre leur utilisation comme lieu d’habitation. Le cours vise à :
- intégrer la rationalité de l'économie des ressources, en particulier l'énergie, comme dimension structurante du projet d’architecture ;
- connaître les principes de la conception énergétique et bioclimatique des bâtiments pour être capable de les appliquer dans le projet ;
- comprendre les interactions entre les éléments statiques et dynamiques du projet (régulation du bâtiment vs climat et occupation dynamiques, bilans saisonniers ou annuels, etc.) ;
- estimer les paramètres énergétiques du bâtiment (R, U, K, Qv, BNC, BNR, E, etc.) et informer le travail de conception architecturale (orientation, choix des matériaux, dimensions et dimensionnement, etc.);
- permettre aux futurs architectes de faire face à leurs responsabilités réglementaires (en Belgique : la PEB) et sociétales.
L'étude de la conception énergétique s'inscrit dans celle, plus vaste, de la conception durable des bâtiments. A travers les exercices de formulation (calcul) et la production d'un dossier d'analyse énergétique de projet (travaux pratiques), l'étudiant.e a l'occasion de comprendre et d'appliquer les divers types de calcul utiles à l'architecte, il apprend et met en pratique la théorie ainsi que les aspects techniques (HVAC).
Le cours est aussi un cours de construction : il considère les implications réciproques de la matière construites (sols, murs, fenêtres, toits, etc.) et de l'énergie (pertes et gains, confort, etc.). Il se base sur l'idée qu'un bon architecte doit aussi être un bon constructeur.
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
La maitrise des compétences arithmétiques de base (+ x - / ) ; la pratique d'un tableur (EXCEL, etc.) est requise pour la production des travaux dirigés : le tableur sera sa base de travail, sa mémoire (des calculs, des plans et photographies, des sources, etc.) et son cadre de travail en examen.
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Le cours est conçu globalement et dispense trois types de compétences. Chacune de ces compétences est évaluée de manière distincte et est pondérée de la manière suivante :
1. Travaux pratiques (35%) : cette compétence porte sur la production d'une analyse énergétique d'un projet choisi par groupe d'étudiants (max 3, voir conditions sur UV). 10 séances obligatoires de travaux sont prévues (6 en Q1 + 4 en Q2) ; cette compétence est évaluée par une correction du tableur au fil de l'année. Les 10 séances sont à considérer comme des travaux “en série”, à savoir que les séances précédentes (1 à n-1) sont nécessaires et doivent avoir été corrigées lors de la réalisation de la séance n. A l'occasion des Travaux dirigés, les enseignants expliquent comment produire les paramètres énergétiques d'un projet, ils répondent aux questions des étudiants, les conseillent sur les meilleures méthodes, sur la manipulation du tableur, etc.
Pour cette partie, les étudiant.es sont également placé dans le rôle de correcteur et auront comme responsabilité complémentaire d'assurer la correction du dossier d'un autre groupe. Ce rôle a pour objectif de prendre du recul par rapport à l'exercice, de pouvoir débattre des méthodes entre groupes et d'améliorer les connaissances par la réflexion collective. Ce travail de correction est également valorisé au sein des 35% des travaux pratiques.
2. Formulation et Calcul (30%) : cette compétence porte sur la formulation et la production dans un tableur des paramètres liés aux transferts énergétiques du bâtiment. Elle est évaluée par un examen en janvier (portant sur le Q1), en juin (Q2) et éventuellement en 2e session (Q1+Q2). Des tests non certificatifs sont disponibles sur l'UV pour s'y entrainer. Cette compétence est abordée au fil du cours, en fonction des chapitres. Le cours renvoie à une série de tests pratiques non certificatifs sont disponibles sur l’UV : les étudiants peuvent librement s’y « faire la main » pour comprendre les concepts vus en cours et se préparer à réussir les questions de calcul de l’examen.
3. Théorie (35%) : cette compétence porte sur la compréhension des concepts, des méthodes, des illustrations, etc. présentés en cours et dans le syllabus. Elle est évaluée par un examen en janvier (Q1), en juin (Q2) et éventuellement en 2e session (Q1+Q2).
Le cours est donné selon 2 fils pédagogiques :
1. les concepts, théories, formulations et calculs etc. sont expliqués dans une logique d'exposés et d'illustrations en suivant le parcours du syllabus;
2. 10 séances de travaux pratiques permettent à l'étudiant.e de produire sa propre analyse énergétique d'un petit projet résidentiel, à la lumière des présentations et explications données par les enseignants.
Ces travaux pratiques se font par groupe de maximum 3 personnes (sauf dérogation octroyée par les enseignant.es) et sont corrigés d’abord entre les groupes, puis par les enseignant.es tout au long de l’année. Il appartient à l'étudiant.e de se maintenir à jour pour être prêt aux travaux pratiques suivants et aux évaluations en examen.
Notre propos pédagogique est de vous rendre compétent.es en énergie du bâtiment par la prise en main d'un dossier concret (learning by doing) qui vous permette de comprendre et réussir les épreuves. C'est à travers les Travaux pratiques que vous vous formerez aussi aux concepts théoriques et aux formulations de calcul, qui constituent les autres épreuves d'examen.
La note de l'UE couvre l'ensemble de ces activités.
Références, bibliographie et lectures recommandées
- Brand, Stewart, How Buildings Learn, Penguin, 1996 (aussi en émissions sur la BBC).
- Coll. Architecture + passive : stratégies, expériences & regards croisés en Belgique, 404 p., novembre 2014 (FR/NL/EN), ULB/RBC.
- De Herde, André, Deprez, Bernard, Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatique, Éditions Le Moniteur, 2005.
- Deprez Bernard et al, Vert Bruxelles : architectures à suivre, Racine, 2009 ; Les Bâtiments exemplaires à Bruxelles se racontent, Racine, 2012.
- Guerriat Adeline, maisons passives : principes et réalisations, L'inédite, 2008.
- ICEB (Bornarel Alain), Le bâtiment frugal, 2016, Paris, www.asso-iceb.org/
- MacKay, David JC, Sustainable Energy Without The Hot Air, UIT Cambridge, 2009 (téléchargeable gratuitement sur www.withouthotair.com)
- be.passive, revue d'architecture passive, www.bepassive.be
- site de la Wallonie www.energie.wallonie.be
- site de Bruxelles-Capitale www.bruxellesenvironnement.be
Support(s) de cours
- Syllabus
- Université virtuelle
Contribution au profil d'enseignement
L'étude des modalités de conception énergétique du projet en relation à son contexte médial (historique, technologique et politique) vise à co-construire avec les autres enseignements et avec les étudiants un noyau (de savoirs, d'attitudes et d'aptitudes) indispensable à la compréhension des questions spatiales et architecturales, à leur problématisation et à la capacité de reconnaître les acteurs avec lesquels l'architecte est susceptible de travailler (bureaux d'études, responsables PEB, administration, etc.). Dans le cadre actuel de crise énergétique et de dérèglement climatique, le cours donne à l'étudiant.e une dimension éco-citoyenne de la pratique de sa profession.
Autres renseignements
Informations complémentaires
La présence aux cours tant théoriques que pratiques est fortement recommandée dans le but d'assurer à l'étudiant.e une continuité de l'enseignement, une compréhension de ses erreurs lors des TPs par la présentation en cours des corrections et points d'attention, une rencontre physique entre les différents groupes pour les TPs, etc.
De plus, toute question concernant la matière adressée par mail par l'étudiant.e trouvera réponse lors de la session de cours suivante uniquement.
Contacts
benoit.quevrin@ulb.be
Campus
Solbosch, Flagey
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Examen écrit
Examen écrit
- Question fermée à Choix Multiple (QCM)
- Question fermée à Réponses Multiples (QRM)
- Question visuelle
- Question ouverte à texte à trous
- Question fermée Vrai ou Faux (V/F)
L'évaluation porte sur toutes les compétences développées en cours : les modalités d'examen peuvent varier (en présentiel / distanciel, en papier / UV, etc.) ; la note d'UE est calculée à partir de trois types d'épreuves. Toutes les épreuves sont présentées en 1e et/ou en 2e session
- Travaux pratiques : 35% de la note totale d'UE ; l'évaluation fait la moyenne d'une note au fil de l'année ;
- La note au fil de l'an est calculée par :
- Représentant 85% de la note des TPs, la moyenne des évaluations faites sur l'année, multipliée par un facteur (compris entre 0 et 1) représentant la participation moyenne de chaque étudiant aux remises des TDs (pour chaque TD, 1 = si vous avez remis vos 10 Tds conformément aux consignes, 0,9 avec un jour de retard, 0,5 en cas de non respect de la feuille de route, etc.).
- Représentant 15% de la note des TPs, la moyenne des corrections faites sur l'année, multipliée par un facteur (compris entre 0 et 1) représentant la participation moyenne de chaque étudiant aux remises des corrections (1 = si vous avez remis vos 10 corrections conformément aux consignes, 0,9 avec un jour de retard, 0,5 en cas de non respect de la feuille de route, etc.).
- La note au fil de l'an est calculée par :
- Questions de calcul : 30% de la note totale d'UE ; cette épreuve est incluse dans l'examen de Q1 et de Q2, éventuellement en 2e session (Q1+Q2). La correction se fait sur l'UV avec une tolérance de 1% sur le résultat.
- Questions de théorie : 35% de la note totale d'UE ; cette épreuve est incluse, sous forme de QCM, dans l'examen de Q1 et de Q2, éventuellement en 2e session (Q1+Q2).
Les examens portant sur le calcul se font sur l'UV en utilisant un tableur personnel, qui sera conservé par l'étudiant.e (utile en visite des copies par exemple).
Il n'est pas prévu de seconde session pour la partie TPs.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
La note de la partie QCM est fixée en appliquant les règles du « Standard Setting ». Conformément aux contenus évoqués ci-dessus, la cote globale de l'UE sera la moyenne arithmétique pondérée des 3 cotes partielles, avec note absorbante à 6/20.
Ceci signifie qu'une note partielle inférieure à 6/20 neutralise le calcul de la moyenne arithmétique pondérée et entraîne que la note partielle la plus basse devient la note de l’UE. Il faut donc au minimum 6/20 dans chacune des 3 activités pour activer le calcul de la moyenne. Seules les notes d'épreuves individuelles réussies (>10/20) peuvent être reportées d'une année à l'autre. Les notes des travaux de groupes des années précédentes ne sont donc pas reportées.
Langue(s) d'évaluation
- français