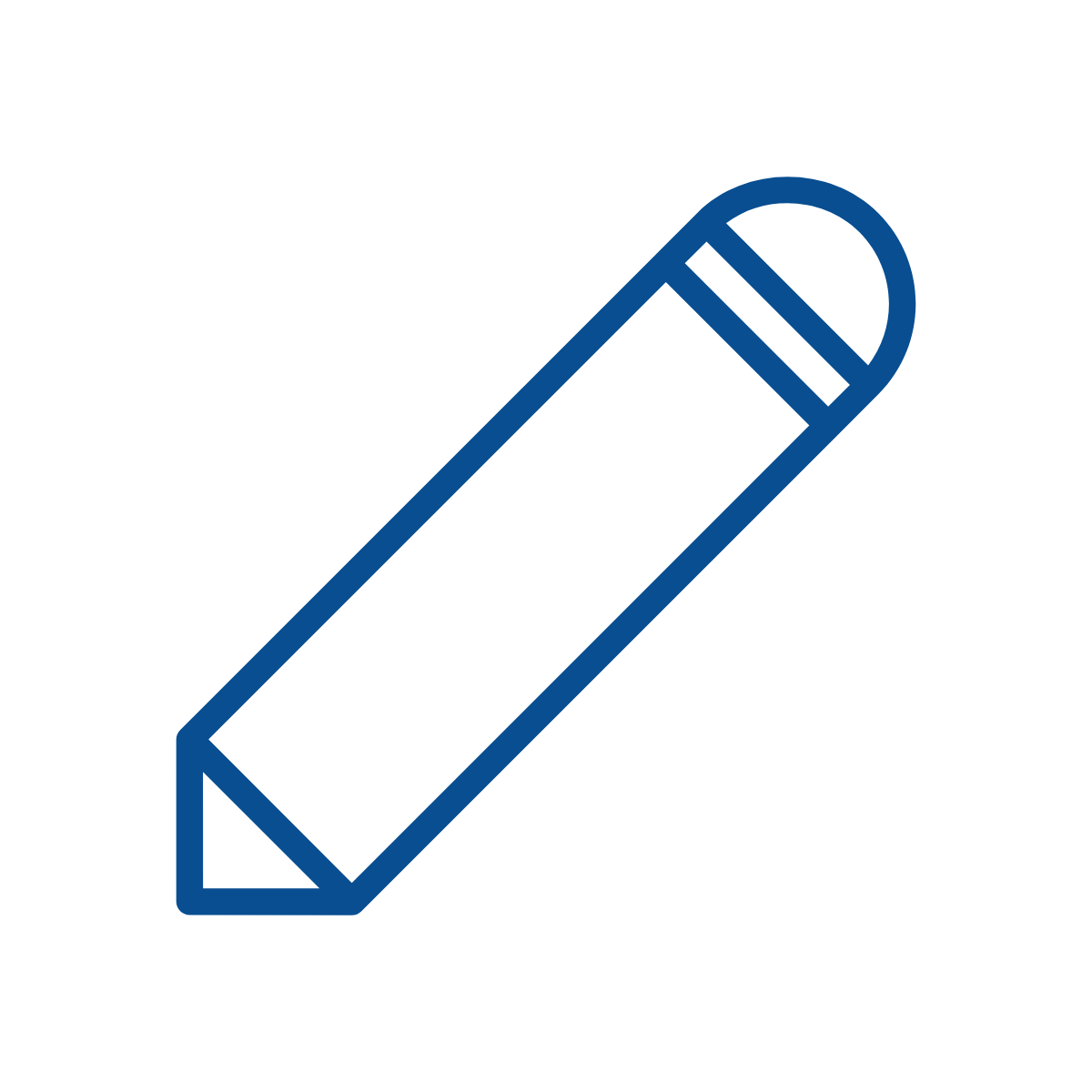-
Partager cette page
Justice restauratrice
Titulaire(s) du cours
Anne LEMONNE (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Apparue il y a plus de 40 ans dans le monde occidental, ses premières pratiques ont été vues comme capables de répondre, de manière constructive et intégrative, aux principaux enjeux auxquels étaient confrontés nos systèmes de régulation pénale et sociale.
A partir des années 1990, la justice restauratrice a occupé une place prépondérante dans les débats relatifs à la justice pénale et à la justice des mineurs, tant sur le plan international, qu’en Belgique.
La plupart des systèmes de justice ont en effet mis en place de nouveaux modes d’action inspirés de ce que certains ont considéré comme un « nouveau modèle de justice » ou une « troisième voie» (entre réhabilitation et rétribution).
Le cours abordera :
- Les principaux fondements épistémologiques, théoriques et les pratiques de la justice restauratrice en resituant leur émergence dans un contexte socio-pénal et historique plus large.
- Il passera en revue les différents modèles et débats qui ont pris place au sein du champ de la justice restauratrice, son cadre normatif et le développement de ses pratiques sur le plan international.
- Enfin, une grosse partie du cours abordera le contexte socio-politique, théorique et normatif dans lequel les pratiques de justice restauratrice se sont développées en Belgique.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
- d’acquérir une bonne connaissance de la justice restauratrice dans ses dimensions
théoriques, normatives et pratiques ;
- de mieux comprendre l’impact des discours et des pratiques de justice réparatrice dans
le champ social en général et pénal en particulier ;
- d’approfondir leur compréhension de la dynamique et des enjeux du mouvement et des
politiques publiques en faveur de la justice restauratrice ;
- d’adopter une grille de lecture critique par rapport à la place, la rationalité et les effets
des discours et pratiques de justice restauratrice.
- de développer, autant que possible, une attention aux savoir-être et savoir-faire concordants avec les valeurs et principes de justice restauratrice (dialogue, inclusivité, non-domination, participation, solutions constructives face aux situations problématiques, écoute des besoins de chacun.e...)
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
- Exposés magistraux et séances interactives et participatives.
- Invitation de personnes extérieures pour offrir aux étudiant·e·s une perspective plus concrète de la justice restauratrice.
- Mise à disposition de portefeuilles de lectures, de vidéos et/ou enregistrements radiophoniques pour illustrer la matière.
Références, bibliographie et lectures recommandées
- PowerPoint et des notes de cours mis à disposition des étudiants
- Lectures recommandées :
CHRISTIE, N., "Conflict as Property", The British Journal of Criminology, Vol. 17, No. 1 (January 1977), pp. 1-15 (15 pages), Published By: Oxford University Press.
LEMONNE, A., CLAES, B., « La justice réparatrice en Belgique : une nouvelle philosophie
de la justice ? », in JASPART, A., SMEETS, S., STRIMELLE, V. ET F. VANHAMME (Ed.).
« Justice ! ». Des mondes et des visions, Montréal : Erudit, coll. Livres et actes, (2014) : 121-
141, https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/justice-mondes-visions--978-2-9813073-
1-6/000169li.pdf
LEMONNE A, « A propos de la 5ème Conférence Internationale sur la Justice Restauratrice.
Accord ou contradiction au sein d’un mouvement en expansion? », Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, Mai (2002) : 411-428.
LEMONNE, A., « La justice restauratrice en Belgique : nouveau modèle de justice ou modalité
de redéploiement de la pénalité ? » Revue de droit pénal et de criminologie, no sept-octobre
(2016) : 911-27.
VAN DE KERCHOVE Michel, « La justice restauratrice au cœur du conflit des paradigmes de la peine », Histoire de la justice, 2015/1 (N° 25), p. 123-133. DOI : 10.3917/rhj.025.0123. URL : https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2015-1-page-123.htm
WALGRAVE, L.," La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme", Criminologie, Volume 32, numéro 1, printemps 1999.
Support(s) de cours
- Syllabus
- Université virtuelle
- Podcast
Contribution au profil d'enseignement
Le cours prolongera les connaissances acquises dans les cours :
- de pénologie
- de théories criminologiques sociologiques
- de protection de la jeunesse
- de politiques pénales
- de procédure pénale...
Autres renseignements
Informations complémentaires
La participation au cours est vivement conseillée, celui-ci tentant dans la mesure du possible de suivre des valeurs et principes de justice restauratrice où la participation de tous et toutes, la co-construction, sont notamment centrales.
L'inscription à 1 séminaire en plus petit groupe, parmi un choix proposé à l'étudiant ou l'étudiante, organisé durant la période d'enseignement, est cependant obligatoire.
Campus
Solbosch
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Autre
Autre
L' évaluation est certes certificative mais se veut aussi formative.
Elle comprend 4 modalités :
1. La participation à 1 séminaire organisé autour d'une thématique avec des intervenant.es extérieures.
2. La réalisation de 5 mini-tests postés sur l'UV au fur et à mesure de l'enseignement. Ces tests sont à faire pour au plus tard pour le début de la session d'examen (date à convenir selon le calendrier de la session - information sur UV page de cours).
3. La réalisation d'un devoir par groupe de 3 personnes (sauf cas de force majeure), sous forme de poster, autour de questions formulées par l'enseignante, à déposer sur l'UV pour le début de la session de janvier (date à convenir selon le calendrier de la session - information sur UV page de cours).
4. La présentation du devoir, réponse aux questions de l'enseignante et participation aux débats lors de mini-séminaires organisés par l'enseignante durant la session d'examen (date à convenir selon le calendrier de la session - information sur UV page de cours).
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Total de l'évaluation : 20 points.
Ces 20 points sont répartis de la manière suivante.
- Participation à un séminaire obligatoire : 1 point
- Réalisation des 5 Mini-tests : 5 points
- Réalisation et dépôt du devoir par groupe de 3 (poster) : 4 points
- Présentation du devoir (4 points) + réponse aux questions (3 points) et participation aux débats (3 points) lors du mini-séminaire
La réussite nécessite que l'étudiant ou l'étudiante ait participé au séminaire obligatoire, ait répondu à l'ensemble des tests, ait réalisé et déposé son poster de groupe et ait participé au mini-séminaire organisé durant la session d'examen.
La non-participation à l'une de ces épreuves implique l'échec de l'étudiant ou de l'étudiante.
Langue(s) d'évaluation
- français