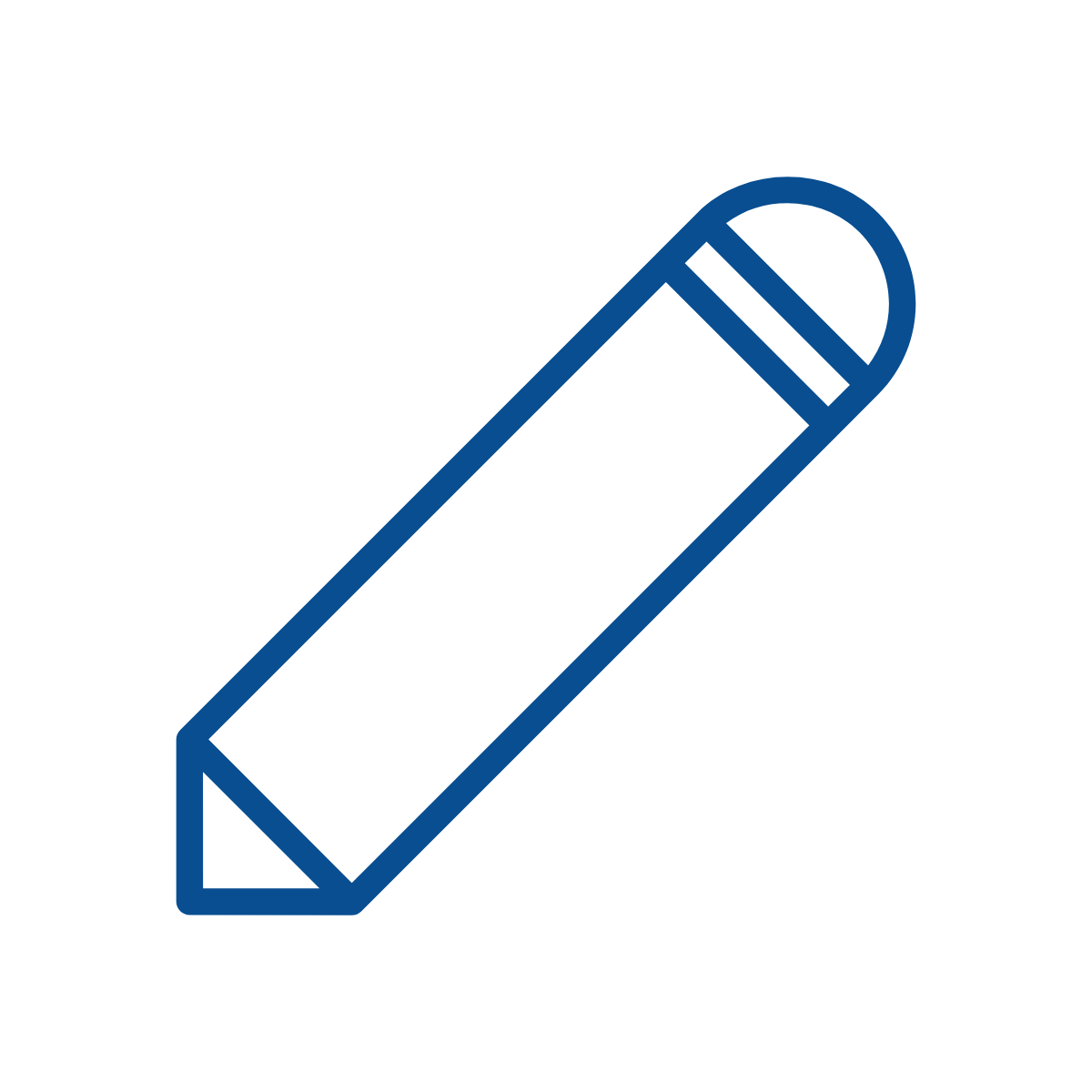-
Partager cette page
Espaces - Genre - Sexualités
Titulaire(s) du cours
Jean-Didier BERGILEZ (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
En revendiquant a Room for One’s Own, Virginia Wolf énonçait il y a près d’un siècle combien les questions de genre et d’(in)égalité se marquent et prennent corps dans l’épreuve spatiale. Les discriminations habituelles entre espace public et espace privé, intimité et extimité, intérieur et extérieur, etc., et plus largement les constructions socio-culturelles de la perception, de l’appropriation et de la conception de l’espace - de l’objet au territoire - participent de logiques qui reflètent, supportent, modifient les structures politiques et sociales de la différence.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Cette unité d’enseignement entend introduire les étudiant.es aux savoirs qui interrogent les rapports entre genre et espaces ; chercher à comprendre en quoi le genre produit de la différenciation spatiale, en quoi, réciproquement, l’espace participe de la différentiation de genre et de la construction des identités, pratiques et expressions ; interroger enfin les fondements même des savoirs genrés des disciplines « spatialistes » et les conditions de leur élaboration.
Par-delà la question du genre, l’unité d’enseignement introduira également – et plus spécifiquement cette année 2025-2026 - aux enjeux d’une analyse des conditions spatiales des sexualités ; ou comment l’espace supporte, conditionne, participe aux expressions, pratiques, performances et représentations de celles-ci.
Au vu de la nature des enjeux et objectifs de l’UE, des acquis délibérément multi- et interdisciplinaires (géographie, sociologie, anthropologie, ethnographie, urbanisme, architecture, histoire, …) seront mobilisés.
Durant cette année académique 2025-2026, le cours, les conférences et les travaux personnels associés s’intéresseront plus particulièrement aux espaces de sexualités. Ouvert aux approches anthropologiques, sociologiques, géographiques, architecturales, historiques, entre autres, le séminaire entendra dresser une cartographie partielle et partiale des questions que ces enjeux soulèvent, à partir des intérêts et expertises des personnes (étudiantes et étudiants, conférenciers et conférencières, enseignant) investies au sein de celui-ci.
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Séminaire - Cours magistral/conférences - Travaux personnels
Le cours repose sur une participation active des étudiant.es. Il est proposé sous la forme d’un séminaire alimenté par une série d’interventions ex cathedra, visites, conférences distinctes dispensées par le titulaire ou des conférencières et conférenciers invité.es, par un programme de lectures et d’analyses de textes et, enfin, essentiellement, par les discussions collectives autour de l’élaboration de travaux personnels.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Les lectures et supports visuels seront mis à disposition des étudiant.es sur l’Université virtuelle ou via Teams (ULB)
Support(s) de cours
- Université virtuelle
Autres renseignements
Contacts
Jean-Didier Bergilez
jean-didier.bergilez@ulb.be
Campus
Flagey
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Travail personnel
- Présentation orale
- Autre
Travail personnel
Présentation orale
Autre
Le travail des étudiant·es sera évalué sur la base d’un article de recherche original, développé tout au long du quadrimestre. L’évaluation portera à la fois sur la qualité du processus de recherche et sur la rigueur de sa restitution écrite. L’objectif est de produire une contribution personnelle et critique à la thématique du séminaire, participant à l’élaboration d’un savoir collectif.
Critères d’appréciation :
(1.) Pertinence et originalité du sujet : capacité à identifier un objet de recherche singulier, en lien avec la thématique générale, et à formuler une problématique claire.
(2.) Approche critique et théorique : aptitude à mobiliser des outils conceptuels pour analyser le sujet, à croiser les sources et à construire une lecture personnelle et argumentée.
(3.) Qualité du travail d’enquête : richesse des sources mobilisées (textes, archives, iconographies, entretiens, etc.), et capacité à en tirer des éléments significatifs.
(4.) Rigueur de la rédaction : clarté de l’écriture, structuration du propos, qualité du style, soin apporté à la mise en forme, aux références bibliographiques et aux illustrations.
(5.) Engagement dans le séminaire : participation active aux discussions collectives, capacité à enrichir le débat et à faire évoluer sa propre recherche au contact des autres.
Deux modes d’évaluation sont prévus :
(1.) Évaluation continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e et sa présence active et engagée durant les cours, les activités et le séminaire (avec remises et présentations intermédiaires de l’état d’avancement de la recherche personnelle et/ou de groupe suivant le programme présenté en début de quadrimestre) (40%);
(2.) Évaluation finale de l’article rendant compte des résultats de la recherche en fin de période (60%).
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Deux modes d’évaluation sont prévus :
(1.) Évaluation continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e et sa présence active et engagée durant les cours, les activités et le séminaire (avec remises et présentations intermédiaires de l’état d’avancement de la recherche personnelle et/ou de groupe suivant le programme présenté en début de quadrimestre) (40%);
(2.) Évaluation finale de l’article rendant compte des résultats de la recherche en fin de période (60%).
Langue(s) d'évaluation
- français