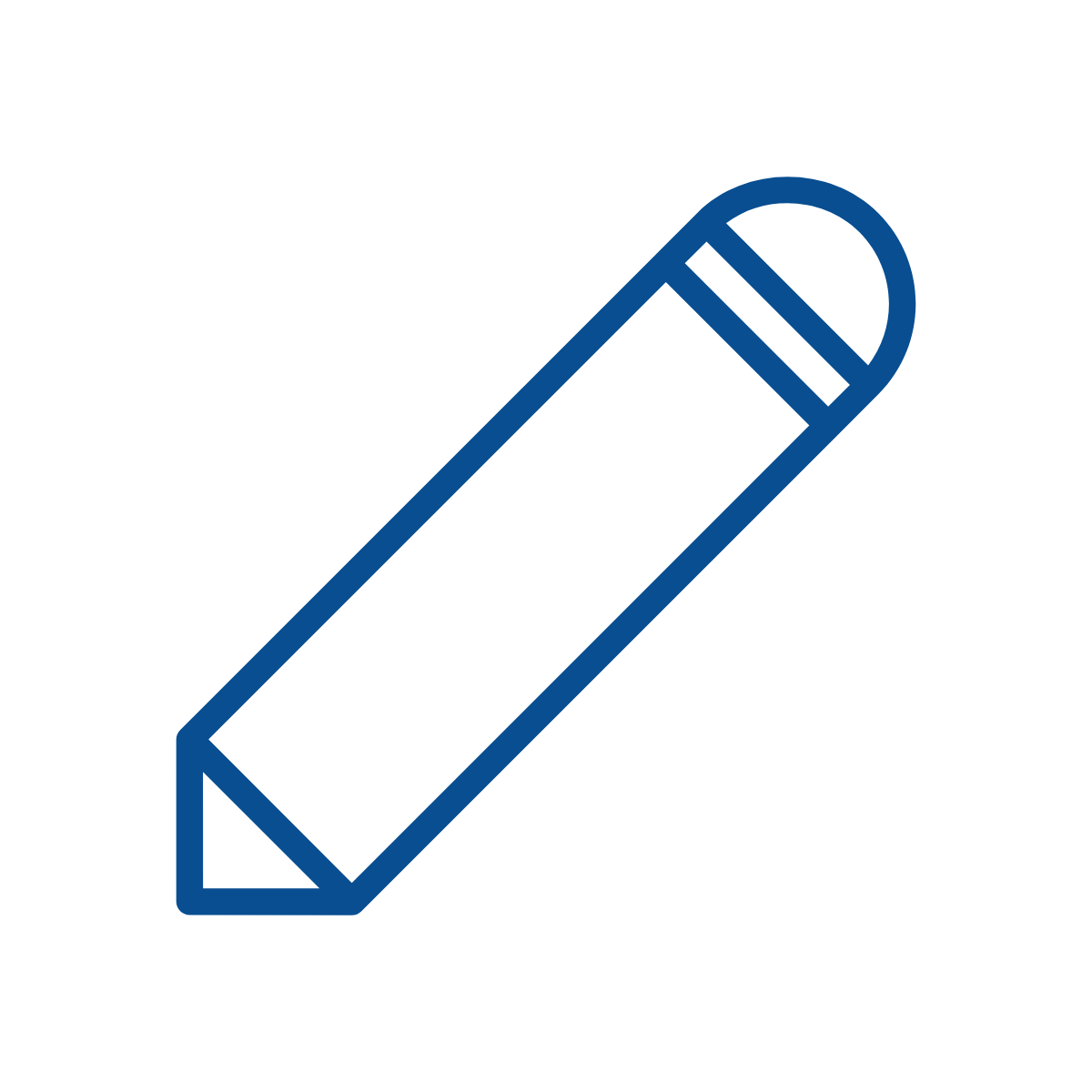-
Partager cette page
Les espaces de l'Histoire
Titulaire(s) du cours
Nicolas VERSCHUEREN (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Le cours est un cours pratique, sur base de travaux dirigés, dans lequel les étudiants devront, par groupe de 4-5 personnes, participer à l'écriture d'un projet collectif de manuscrit autour de l'histoire d'un bâtiment en y associant une perspective scientifique tout en intégrant une visée grand public. Ce dernier point permettra de participer à une réflexion autour de la notion d'histoire publique. L’histoire publique étant définie ici comme une pratique de l’histoire sortant de certains canons universitaires pour atteindre un public plus large et/ou proposant des formes variées de diffusion du savoir universitaire. Etant donné le nombre d'étudiants et d'étudiantes suivant le cours, deux bâtiments sont d'ores et déjà sélectionnés, le travail par groupe constituera donc une division du travail par période. Ce projet nécessitera une dynamique collective et un travail continu d'évaluation. Si le nombre d'étudiants inscrits le permet, nous essaierons de nous limiter à un seul bâtiment afin de pouvoir travailler de manière hebdomadaire.
Les étudiants seront donc amenés à travailler collectivement au sein de leur groupe mais également entre les groupes, puisque certaines démarches seront communes à plusieurs groupes travaillant sur le même sujet.
Ce cours intitulé les « espaces de l’histoire » propose donc aux étudiants de mettre en application pratique et concrète les premiers acquis qu'ils ont obtenus au cours de leur formation. À terme, ce cours visera à investiguer la question de la Digital History et de ses implications pour la formation et le métier de l’historien et de l'historienne.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Les objectifs pédagogiques de ce cours sont :
- Initier les étudiants à l’histoire publique et ce que signifie cette pratique de l’histoire
- Apprendre à travailler en groupe
- Poursuivre la formation des étudiants en termes de recherches bibliographiques
- Consolider les apprentissages de la démarche heuristique
- Développer l'esprit de synthèse et la capacité à exprimer clairement les éléments issus de cette synthèse
- Développer des compétences en matière de narration historique
- Offrir la possibilité d'explorer d'autres formes de communication de la recherche historique
- apprendre à constituer une corpus documentaire
- Développer des capacités à construire un réseau afin de mener à bien un projet éditorial
- S'initier aux démarches de la production éditoriale.
- Former à l'expression écrite des résultats scientifiques
- Explorer des ouvrages essentiels ou originaux dans leur approche au sein de la discipline historique
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
Il est attendu des étudiants de :
- De pouvoir manier facilement des outils de recherche (Catalogue de bibliothèques, Google Scholar, Cairn,…)
- D’écrire de manière que le texte soit compréhensible et d’être attentif à la forme ainsi qu'à l'appareil critique (notes de bas de page, bibliographie,...)
- D’être capable de référencer correctement leur travail
- De synthétiser les recherches et publications en histoire
- de connaître les centres d'archives où le travail heuristique les guidera
- disposer d'une véritable appétence pour la recherche historique
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Le cours sera organisé en atelier de discussion par groupe d'étudiants. Il y aura peu de présentation ex cathedra. La présence est obligatoire et un suivi de l'évolution du projet sera organisé toutes les deux semaines.
Le premier cours sera consacré à la présentation du projet pédagogique, du calendrier, des deux thématiques, du fonctionnement des groupes. Pendant ce cours, les deux bâtiments seront présentés en insistant sur la particularité et l'intérêt scientifique des deux projets. Des premières pistes heuristiques seront déjà proposées . Ensuite, une discussion doit s'ouvrir entre les étudiants pour constituer les groupes. La suite du cours sera consacrée à l'organisation du travail, des séances, des attendus et des évaluations. En fonction du nombre d'étudiants, le calendrier et l'organisation du travail seront ajustés.
Dès le cours suivant, les groupes seront divisés en deux cohortes qui seront amenées à venir au cours alternativement une semaine sur deux afin de laisser du temps pour le travail et pour fournir suffisamment de temps pour que le professeur et l'assistant puissent accompagner efficacement le travail de chaque groupe.
L'investissement fourni avant et lors de chaque séance fera l'objet d'une évaluation permettant un suivi continu du travail. Les groupes d'étudiants et étudiantes devront ensuite remettre le travail collectif final dans le courant du mois de décembre ou janvier en fonction du calendrier choisi par les étudiants et étudiantes.
Une présentation orale d'une heure par cohorte (ou par thématique) est prévue lors du dernier cours et fera l'objet d'une évaluation relative à la maitrise du sujet, à la pertinence du propos et à la fluidité de l'exposé.
Au vu de la configuration pédagogique particulière du cours, la remise d'un travail en seconde session n'est pas possible. Le cours est pensé dans une logique de suivi continu et d'investissement hebdomadaire se concluant par un travail écrit. La reconduction de ce dispositif dans une autre session n'est pas possible et une évaluation alternative impliquerait un dispositif pédagogique ne correspondant plus aux buts de ce cours.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Les recommandations bibliographiques varient en fonction des thématiques/sujets/terrains choisis et sont faites en séance.
Support(s) de cours
- Université virtuelle
Contribution au profil d'enseignement
Cette nouveauté pédagogique dans le cursus de la filière d'histoire doit permettre la mise en pratique de compétences (recherche scientifique sur un thème, vulgarisation et dissémination des savoirs, recherche documentaire), d’investiguer de nouveaux espaces où l’historien puisse s’exprimer et de développer l'autonomie et la collaboration dans le travail mais également d’ouvrir à des dimensions pratiques du métier d'historien.
L'objectif est donc que les étudiants et étudiantes disposent d'une première expérience relative aux dispositifs à mettre en oeuvre dans l'optique d'écrire un manuscrit historique.
Autres renseignements
Informations complémentaires
La présence au cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée. À partir de trois absences non justifiées, l’étudiant sera considéré comme absent pour l’entièreté du cours et ne pourra pas présenter un travail en seconde session puisque cette possibilité n'est pas faisable en raison de l'organisation pratique du cours.
En cas d'échec, il n'y aura pas de possibilité de remise en seconde session ou d'évaluation alternative.
Contacts
Nicolas.verschueren@ulb.be
Campus
Solbosch
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Présentation orale
- Travail de groupe
Présentation orale
Travail de groupe
L'évaluation portera sur trois aspects
1° l'investissement avant et durant les séances de cours
2° la production d'un travail écrit d'une trentaine de pages
3° la présentation orale lors du dernier cours
L'investissement et l'enthousiasme mis dans le développement du projet du groupe est essentiel puisqu'ils correspondent à une dimension de l'histoire publique à savoir la volonté de diffuser et d'atteindre un public plus large que le monde universitaire lié à sa discipline tout en maintenant une rigueur scientifique. L'objectif est que les étudiants s'approprient leur thématique et puisse transmettre avec conviction la pertinence (ou non) de ce travail d'historien ou d'historienne
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
La note sera construite à partir de trois éléments
- suivi continu 4 points
- exposé oral 4 points
- travail écrit 12 points
Langue(s) d'évaluation
- français