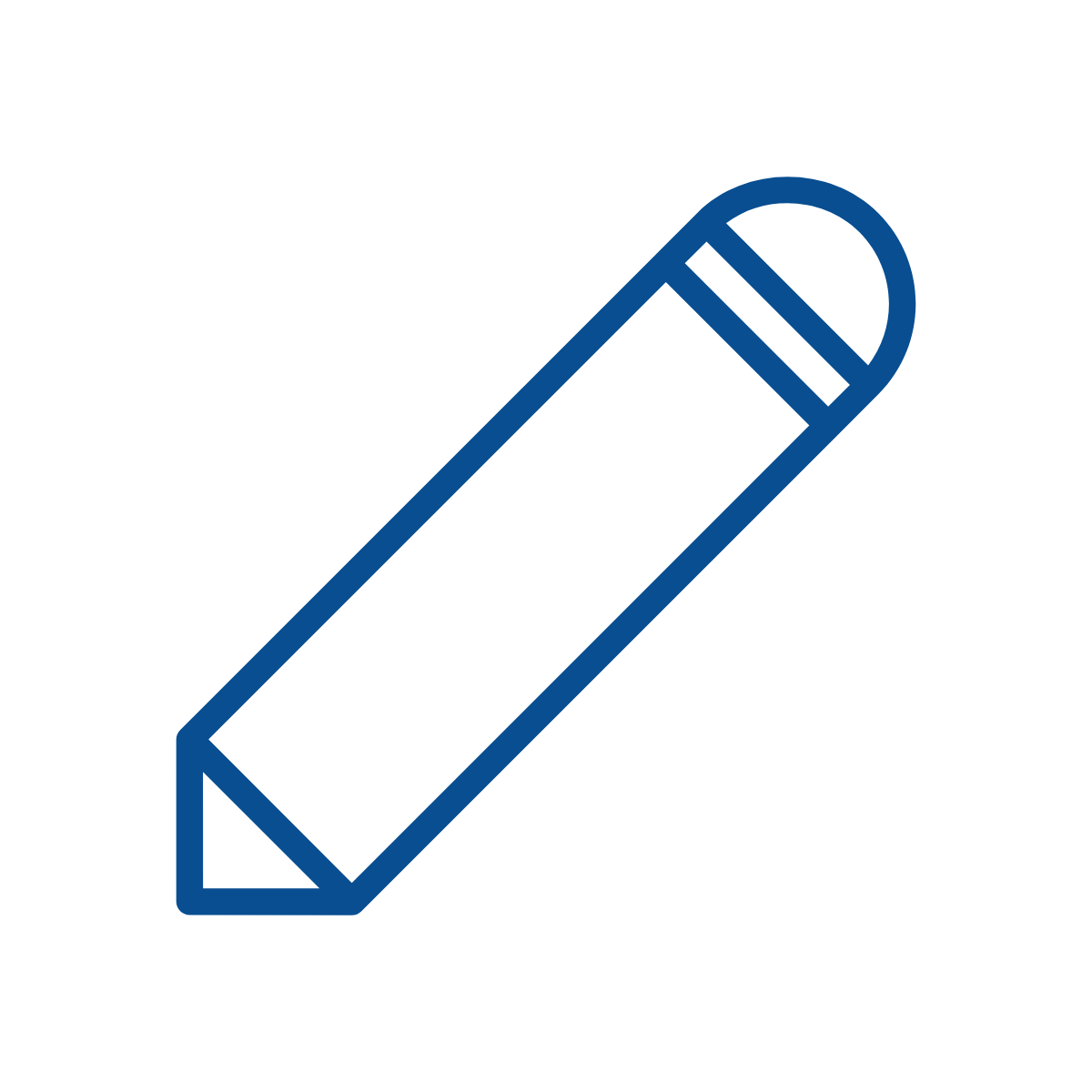-
Partager cette page
Projet d'architecture 2
Titulaire(s) du cours
Iwan Aldo STRAUVEN (Coordonnateur), Benjamin BULOT, Mar-Nadia CASABELLA ALVAREZ et Marc MAWETCrédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Le projet, compris comme outil de connaissance, est :
• un espace de lecture (apprendre à poser un problème d’architecture - l’analyser, le documenter, le critiquer)
• un espace de conceptualisation (apprendre à formuler des intentions, pour passer des idées aux objets)
• un espace de formalisation (apprendre à concrétiser une solution, à « construire » l’objet)
• un espace de vérification, d’évaluation et de validation (apprendre à instruire une critique de l’objet conçu)
• un espace de transmission (apprendre à représenter et à communiquer hypothèses et solutions)
La conception d’un projet d’architecture est un processus qui convoque donc la mise en œuvre de savoir-faire (le « comment ? »), et l’affirmation de points de vue ou de prises de position (le « pourquoi ? »).
Le travail en Projet BA2 est strictement horizontal : Toutes les questions, objectifs et évaluations sont identiques pour l’ensemble des étudiant·es. L’atelier étant divisé en deux entités distinctes, elles-mêmes réparties en 4 ou 5 entités, les programmes et modes d’organisation peuvent être différents sans pour autant contrevenir à ces questions, logiques, modalités et évaluations.
Chaque quadrimestre est thématisé suivant une logique pédagogique progressive, de complexité croissante :
■ Le Q1 se focalise sur les questions de « l’habiter » : les relations de l’être humain avec son environnement immédiat, à une échelle « domestique », dans un contexte urbain donné ou non (si l’exercice se consacre exclusivement aux logiques spatiales et formelles) ou non (si l’exercice se consacre exclusivement aux logiques spatiales et formelles).
■ Le Q2 élargit et complexifie le champ des réflexions contextuelles et programmatiques, pour engager une recherche sur le caractère public de l’architecture, située dans la ville.
Transversalement, tous les travaux de l’année contribuent à développer et consolider différents champs de compétences indispensables et complémentaires au coeur d’un processus itératif :
■ la narration d’intentions et de stratégies projectuelles clairement exprimées,
■ la représentation qualitative de l’architecture en 2D et en 3D,
■ l’exploitation de références architecturales judicieusement choisies et bien analysées,
■ la composition et l’expression de projets incarnés.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
L’enseignement se fixe pour dessein essentiel d’accompagner l’étudiant·e dans un cheminement vers l’autonomie, en consolidant les acquis antérieurs, et en faisant découvrir les clés de l’épanouissement dans les années supérieures.
Dans cette perspective, les objectifs fondamentaux du cours de Projet d'Architecture 2 peuvent être synthétisés en quelques points :
• Le développement de la connaissance de l’architecture, entendue comme une discipline spécifique du traitement de l’espace, qui conduit à aborder des questions programmatiques, compositionnelles, contextuelles, matérielles, structurelles, …
• La consolidation des méthodologies, des outils et des savoirs indispensables à la pratique du projet.
• L’enrichissement de la culture architecturale.
• L’initiation d’une réflexion critique sur l’architecture et ses relations avec la société.
• L’épanouissement de la sensibilité, de la créativité et de l’esprit de discernement.
Critères d'évaluation
Les compétences indispensables, que l’atelier souhaite transmettre, consolider et vérifier, constituent une liste de critères objectifs qui seront les références pour l’évaluation des acquis :
1/ Prise de position
• Capacité d'analyser, comprendre et travailler de manière critique un programme.
• Capacité d'étayer un projet par des références et/ou des arguments théoriques.
• Capacité de fonder et de formaliser une réponse architectonique à la question posée, en considérant, notamment, le paramètre de l’insertion dans un lieu – compréhension et valorisation des caractères du contexte (physique et humain) lorsque l’exercice est territorialisé
/ Systèmes distributifs
7/ Engagement dans l’atelier (objet de l’évaluation permanente)
• Capacité d'auto-évaluer son projet, sa démarche, son propos.
• Qualité du processus de création
• Présence et assiduité à l'atelier (conformément à l’Article 61 du RGE) Il est précisé ici que la présence ne peut être entendue que sous l’angle d’une activité réelle et avérée, au service du projet individuel autant que d’une intégration collective. Elle se vérifie en terme de capacité à écouter, dialoguer, argumenter, intégrer les éléments des débats à travers une évolution significative du projet. A contrario, une présence passive et qui ne témoigne d’aucun engagement dans le projet ou d’aucun résultat probant d'évolution sera plutôt interprétée comme un manque de compétence et de moyens.
Ces compétences et ces sept critères d'évaluation doivent tous être rencontrés de manière simultanée. L'insuffisance à un seul critère peut engendrer une côte certificative insuffisante.
Pré-requis et Co-requis
Cours pré-requis
Cours ayant celui-ci comme pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
L’atelier est le lieu où naît le projet.
• C’est un lieu de travail partagé où s’opère la synthèse de tous les apprentissages, théoriques et pratiques.
• C’est un lieu de recherche et d’expérimentation où l’on apprend par le plaisir de « faire », par l’intuition, par l’analyse, par la remise en question et la pratique de l’esprit critique.
• C’est un lieu d’échange et de débat. Étudiant·es et enseignant·es constituent ensemble un vaste forum, où la parole est libre, et la multiplicité des opinions encouragée, pour autant que chaque proposition soit étayée par des documents explicites et par un propos fondé.
• C’est un lieu d’éveil et d’enrichissement. Les réflexions sont nourries par les recherches personnelles des étudiant·es, par les exposés des enseignant·es et par les interventions de professeurs de cours de théorie ou d’invités extérieurs.
Les exercices sont la raison d’être et le substrat du travail en atelier.
• De temporalités différentes et de difficultés croissantes, ils proposent de découvrir et d’expérimenter, individuellement et/ou collectivement, les différentes facettes de la pratique architecturale, de manière progressive, avec des objectifs ciblés, qui ne prétendront jamais à l’exhaustivité.
• Considérant que l’architecture est, avant tout, une production prospective, culturelle et citoyenne, les exercices sont toujours fondés sur une thématique qui transcende les strictes contraintes fonctionnelles. Le programme devient alors prétexte pour explorer les champs de cette discipline, pour s’interroger sur les environnements, les modes de vie, les ressources, les usages auxquels il se réfère.
• Les ambitions particulières, les critères d’appréciation spécifiques, les exigences en termes de documents sont toujours précisés dans l’énoncé de chaque exercice.
Tous les projets sont travaillés en groupe (réflexion globale) avec une production individuelle intégrée à cette réflexion globale, soit dans le projet (projet individuel intégré), soit dans la répartition individuelle de sa représentation.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Les conseils de lecture sont communiqués régulièrement par les enseignant·es, au fil des exercices, et en relation avec les questions abordées.
Contribution au profil d'enseignement
Par la pratique intensive du projet, l'unité d'enseignement Projet d'Architecture 2 développe les capacités de l'étudiant·e à rencontrer les trois objectifs inscrits dans le Profil d'enseignement de Bachelier en Architecture ULB, à savoir : 1) Instruire une question architecturale, 2) Elaborer une réponse spatiale située, 3) Interagir avec l'ensemble des acteurs.
Autres renseignements
Informations complémentaires
QUELQUES REGLES ESSENTIELLES CORRESPONDANT AU RGE - RAPPEL
Article 63 du RGE : Les épreuves orales sont publiques.
Article 71 du RGE : L’horaire des épreuves certificatives est communiqué aux étudiants au moins un mois avant le début de la période d’évaluations, conformément à l’article 134 du décret. Sauf cas de force majeure, aucune modification ne peut être apportée à l’horaire d’une épreuve moins de 10 jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Les ordres de passage des étudiants sont eux communiqués indifféremment à l’avance ou le jour-même de l’épreuve.
Article 71 du RGE : Un étudiant qui ne se présentera pas aux lieux et dates fixés par l’horaire sera déclaré absent. La présence à une épreuve d’évaluation sera attestée par une liste de présence nominative.
Article 75 du RGE : Un étudiant qui, pour des raisons graves et exceptionnelles, ne peut prendre part à une épreuve ou une partie d’épreuve peut solliciter une modification d’horaire, dans les limites des contraintes horaires et matérielles d’organisation des évaluations. En cas de désaccord entre le titulaire et l’étudiant, ce dernier peut solliciter, par écrit, l’arbitrage du président du jury ou du Doyen de faculté.
Toutefois, l’envoi d’un certificat médical ou de tout autre document officiel justificatif d’absence ne peut être considéré comme une raison suffisante donnant droit automatiquement à un report d’épreuves à une date ultérieure au cours de la même période d’évaluations.
Disposition complémentaire en Faculté d’Architecture
Tout certificat médical doit parvenir au secrétariat de la Faculté dans les cinq jours ouvrables à dater du début de la période d'absence. Dès son retour, l'étudiant a le devoir de s'informer auprès des enseignants concernés des engagements auxquels il devra satisfaire.
Modalités spécifiques relatives au projet en cas d’absence à un jury :
Le projet ne fait jamais l’objet d’une seconde session ni d’une session ouverte.
Que faire en cas d’absence à une remise ou à un Jury?
· Le jour de l’échéance, faire remettre par un tiers l’ensemble du travail, en l’état.
· Le même jour, transmettre au coordinateur de l’atelier la copie du certificat médical ou de tout autre
justificatif officiel écrit (l’original sera transmis dans les plus brefs délais au secrétariat).
· A la séance d’atelier suivante, présentation du travail devant un « jury de rattrapage ».
=> Le non-respect de ces exigences entraînera une note nulle pour la remise.
· Pour le jury de fin d’année, aucun jury de rattrapage n’est possible. Les travaux remis en l’état seront
examinés par le jury, même en l’absence de l’étudiant.
Article 76 du RGE : Il est interdit de se présenter à un examen durant la période couverte par un certificat médical. Un étudiant qui présente un examen sous certificat médical est considéré comme absent.
Article 80 du RGE : À l’issue de l’épreuve orale, l’examinateur peut communiquer à l’étudiant la note obtenue ou une indication de son évaluation. En cas de demande de l’étudiant, il est tenu de le faire. Il explique, chaque fois que cela paraît nécessaire, le pourquoi de son appréciation afin de permettre à l’étudiant de connaître ses déficiences et d’améliorer sa méthode de préparation.
Dispositions liminaires du RGE, point g) Droit à l’image :
L’étudiant est tenu de demander l’autorisation de l’enseignant ou de tout autre intervenant s’il souhaite enregistrer (prise de son et/ou d’images) l’enseignement ou toute autre prise de parole. Si l’autorisation est obtenue, l’étudiant est tenu de respecter le but pour lequel elle a été donnée, à savoir, en règle générale, un but d’aide individuelle à l’étude et à la compréhension.
À moins que la nature de la prestation ne le justifie, aucun examen oral ne peut donner lieu à un enregistrement, ni par l’étudiant ni par l’enseignant.
QUELQUES REGLES ESSENTIELLES CORRESPONDANT A L’ATELIER
° Les consignes ou documents qui concernent des évaluations certificatives sont transmises via l’UV.
° Les consignes ou documents, transmis par les équipes pédagogiques (binômes) ou les coordinateurs (Iwan Strauven ou Marc Mawet) pour l’organisation de l’atelier ou des ateliers - informations générales, informations spécifiques à des groupes, consignes ponctuelles ou spécifiques à un atelier, transmissions de références ou d’articles, synthèses et/ou conclusions de rencontres, etc….. sont transmises via Teams, dans les canaux des ateliers ou dans UV ou dans le canal général de Teams si cela concerne tous les ateliers.
° L’ensemble des informations concernant l’atelier, sa philosophie, les membres qui le constitue, le programme, les thèmes, les modalités de fonctionnement etc….. sont reprises dans un ou des document(s) introductif(s) qui sont présentés lors de la séance d’ouverture de l’année académique et lors de la séance d’introduction du Q2. Ils sont ensuite accessibles via Teams ou via UV.
° Le processus de projet étant un processus itératif dépendant de l’investissement humain et des compétences des étudiants, il est impossible, contre-nature, d’anticiper arbitrairement et très précisément en début d’année la manière dont son enseignement se déploiera. Dès lors, des modifications à la marge, des évolutions inhérentes à ce caractère itératif font partie de la pratique et de l’enseignement du projet et doivent être acceptées comme telles par les étudiants. En fonction de leur importance dans l’organisation du travail des étudiants et de leurs échéances multiples, elles seront transmises via teams (mineur) ou l’UV (majeur). Jamais par les deux canaux simultanément. Elles seront concertées ou non en fonction du sujet.
Contacts
Iwan.Aldo.Strauven@ulb.be
Marc.Mawet@ulb.be
Campus
Autre campus
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Projet
Projet
Deux modes d’évaluation sont prévus :
1. Une évaluation formative continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e (avec remises intermédiaires, aux dates convenues, de l’état d’avancement des recherches, et projets de groupe et individuels) et sa participation active et engagée durant les ateliers. Ces évaluations formatives seront communiquées à l’étudiant·e tout au long de l’année, à l’issue des moments-clé, avec une synthèse de celles-ci à l’issue du premier quadrimestre.
2. Des évaluations certificatives à l’issue de chacun des quadrimestres.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
La pondération de la note de l’UE se base sur les évaluations certificatives, selon la pondération suivante :
- Évaluation certificative du jury fin de Q1: 20 %.
- Évaluation certificative de projet - évaluation intermédiaire Q2 : 20 %
- Evaluation continue et certificative (travail en atelier): 10%
- Évaluation certificative du jury fin de Q2: 50 %.
La note de l’UE Projet sera la moyenne arithmétique pondérée de ces notes certificatives.
Pour information: il n’y a pas de rapport mathématique direct entre les évaluations formatives et l’évaluation continue, même si ces évaluations sont un des éléments dont on tient compte dans la construction de la cote d’évaluation continue.
La note globale représente 20 ECTS sur une année académique, soit deux quadrimestres d’enseignement, non fractionnables
Pour acquérir les crédits de l’unité d’enseignement, il faut impérativement obtenir une note finale égale ou supérieure à 10/20.
Il n’existe pas de seconde session en Projet d’Architecture.
Différentes formules de jury ou d’évaluations pourront être appliquées :
° Interne silencieux, hors de la présence des étudiants, par les enseignants du Projet 2
° Interne avec présentation orale des étudiants, par les enseignants du Projet 2
° Elargi avec présentation orale des étudiants, par les enseignants du Projet 2, accompagnés d’invités extérieurs, de la faculté ou d’ailleurs
Les membres de groupes d’évaluations certificatives et de jury sont des académiques de la faculté ou d’autres facultés (toutes universités confondues), des scientifiques de la faculté ou d'autres facultés (toutes universités confondues) et des praticiens d’architecture. Chaque membre du jury intervient à part égale dans l’attribution des notes.
Chaque échéance cotée est indépendante : son résultat n’a aucune incidence sur les autres résultats.
Sanctions de retard de remise
Pour un jury avec évaluation certificative, les documents sont déposés sur l’UV la veille des deux journées de jury entre 18:00 et 22:00. Les retards entre 1 minute et dix heures sont sanctionnés de 20% de la cote. Les retards de plus que dix heures sont sanctionnés de 50% de la cote. Tout problème rencontré avec la plateforme UV sera immédiatement notifié par mail aux enseigant·es et aux coordinateurs (Iwan Strauven et Marc Mawet). Les fichiers seront dans ce cas envoyés par une plateforme de transfer de données (p.e. : swisstransfer ou autre) aux enseigant·es et aux coordinateurs. Le moment de réception de ces transferts déterminera l’éventuelle application d’une sanction de retard.
Langue(s) d'évaluation
- français