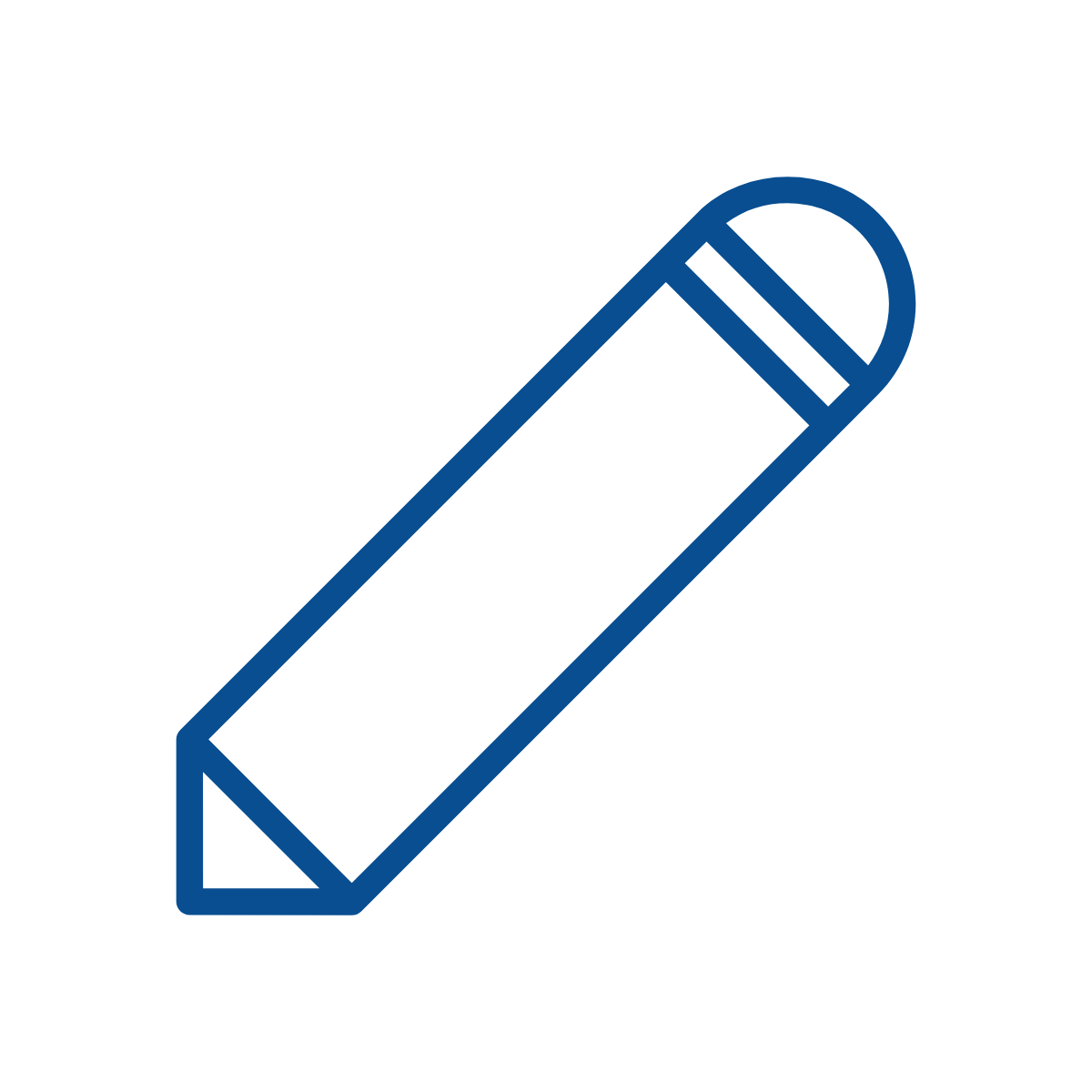-
Partager cette page
PROJ-P4324
Projet d'architecture 4.24 : VIDE - Ville Invisible, Décroissante et Engagée
Titulaire(s) du cours
Jean STERNO (Coordonnateur) et Pierre EMANSCrédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
L’atelier "VIDE" a pour ambition de former des architectes critiques capables de penser au-delà des formes matérielles traditionnelles, pour se concentrer sur le vide comme levier de transformation sociale. En replaçant le vide au cœur des préoccupations architecturales, ce programme invite les étudiants à imaginer des espaces capables de réinventer la vie humaine et le bien-être collectif. L’atelier ambitionne de faire de l’architecture un outil de critique sociale, un moyen de transformer les rapports de force et de contribuer à un avenir commun plus équitable et solidaire.
Le VIDE comme Espace de Résistance Les territoires abandonnés par le capital deviennent des opportunités pour repenser les espaces urbains et en faire des lieux de réappropriation et de résistance collective. L’atelier questionne ce vide urbain en tant qu'espace de potentialités, où l’objectif n'est pas de proposer des réponses figées, mais d'explorer des projets expérimentaux, où le doute et la réflexion critique jouent un rôle central dans la construction du projet.
Un Laboratoire Dialectique et Collectif L’atelier doit être perçu comme un véritable laboratoire de réflexion dialectique. Ici, les projets individuels sont mis en résonance avec une thématique commune, créant ainsi une émulation collective. Ce processus collaboratif permet d'alimenter une pensée critique où les idées et théories sont partagées et enrichies mutuellement. Le projet architectural est ainsi vu comme un processus intellectuel avant d’être une matérialisation concrète, un outil de remise en question des structures sociales et des dynamiques de pouvoir.
Replacer l’Homme au Centre des Réflexions L’objectif fondamental de l’atelier "VIDE" est de replacer l’Homme et son rapport à l’espace au centre de nos réflexions. Il ne s'agit pas seulement de produire des espaces physiques, mais de comprendre les transformations sociales, économiques et culturelles qui façonnent l’espace urbain. Nous explorons les pratiques sociales, les dynamiques territoriales, et nous interrogeons continuellement la place de l'architecte dans la société et sa capacité à agir comme un agent de changement. En intégrant ces éléments, l'atelier vise à créer des espaces où l’Homme peut s’émanciper, s’approprier son environnement et échapper aux logiques d’aliénation imposées par le capital.
Exploration du Vide : Entre Derrida et Klein S’inspirant des théories de Jacques Derrida et des expérimentations d’Yves Klein, l’atelier conçoit le vide non pas comme une absence ou un manque, mais comme un espace plein de potentialités. Derrida parle de "différance", un espace où les significations sont mouvantes, en perpétuel devenir. Klein, avec son exposition "Le Vide" de 1958, explore comment un espace apparemment vide peut être chargé de significations infinies et d'émotions. Appliqué à l'architecture, le vide devient un champ d’expérimentations créatives, où les tensions sociales et culturelles peuvent être transformées en de nouvelles formes d’innovation et de liberté.
Reconsidérer le Vide Urbain Dans le cadre du projet "VIDE", ces espaces urbains vides ne sont plus perçus comme des terrains à combler, mais comme des lieux de création et d'innovation sociale. En s’appropriant ces vides, l’atelier ouvre des perspectives de transformation urbaine radicale, où la diversité et la complexité peuvent s’exprimer librement. Le vide devient ainsi un outil critique pour subvertir les structures de pouvoir existantes et créer des espaces de liberté, d’expression et de justice sociale.
L’atelier "VIDE" transcende la pratique architecturale traditionnelle pour devenir un lieu de réflexion critique et de transformation sociale. Il s'agit de réinventer la manière dont nous concevons et habitons les espaces urbains, en plaçant l’humain au centre des préoccupations architecturales. À travers l'appropriation du vide, nous créons des espaces où l’émancipation individuelle et collective devient possible, et où la résistance aux forces du capitalisme peut s’exprimer pleinement. En fin de compte, l'atelier cherche à utiliser l'architecture comme un levier pour construire un avenir plus juste et plus équitable.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
-
Explorer le vide comme concept central en architecture : Comprendre le vide non seulement comme une absence physique, mais comme un espace plein de potentialités, capable de structurer les relations sociales, urbaines et spatiales.
-
Réflexion critique et dialectique : Développer une attitude critique en s'appuyant sur des théories contemporaines et historiques (Derrida, Klein, Tafuri), en questionnant les dynamiques sociales, politiques et économiques qui influencent l’architecture et l’espace urbain.
-
Conception du vide comme espace de résistance : Réapproprier les espaces urbains laissés vacants par le capitalisme et le tourisme de masse. Transformer ces vides en lieux de création, d'innovation sociale et d'expérimentation architecturale.
-
Approche interdisciplinaire des arts de l’espace : Relier architecture, urbanisme, arts visuels, design et performance pour comprendre comment différentes disciplines exploitent et transforment le vide dans leurs pratiques.
-
Rendre intelligibles les dynamiques territoriales et sociales : Replacer l’humain au centre des réflexions architecturales et explorer comment les transformations territoriales impactent les formes spatiales, les pratiques sociales et les cultures urbaines.
-
Maîtriser les outils de composition, de représentation et de communication propres à l’architecture : Développer la maîtrise des principes fondamentaux de la composition architecturale (symétrie, proportion, hiérarchie spatiale, axes) ainsi que des techniques de représentation et de communication du projet.
Ces objectifs visent à former des architectes indépendants capables de penser, d’écrire, de composer avec virtuosité au-delà des formes matérielles traditionnelles, tout en s'engageant dans des dynamiques sociales et critiques au service d’un urbanisme plus juste et humain.
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
Bases solides en théorie architecturale et urbanisme : Connaissance des principales théories de l'architecture et de l'urbanisme, avec un intérêt pour les approches critiques et philosophiques.
Capacité de réflexion critique: Aptitude à analyser et questionner les formes spatiales et les dynamiques sociales en lien avec l'architecture, notamment dans le contexte urbain et historique.
Intérêt pour l’histoire de la pensée critique : Familiarité avec les grandes figures de la pensée critique, telles que Karl Marx, Michel Foucault, Henri Lefebvre, Guy Debord, Gilles Lipovetsky, … et leurs implications sur l'architecture et l'espace urbain. Cette connaissance permet de situer les projets architecturaux dans un contexte théorique plus large, en s'appuyant sur l'analyse des rapports de pouvoir, des dynamiques sociales et des processus de transformation spatiale.
Maîtrise des capacités de dessin à la main : Compétences en dessin manuel et maquette, essentielles pour l'esquisse et la représentation graphique d'idées lors des phases de réflexion de conception et d’écriture du projet.
Maîtrise des outils de composition en architecture : Connaissance approfondie des outils de composition architecturale liés à l'histoire et à la théorie de l'architecture (symétrie, proportion, hiérarchie spatiale, axes, rythmes, etc.). Cette maîtrise permet de concevoir des espaces selon les principes classiques et modernes de l'architecture, tout en intégrant des réflexions critiques contemporaines.
Intérêt pour une approche interdisciplinaire : Ouverture à l'exploration de pratiques connexes telles que les arts visuels, le design d’intérieur, le paysage, et la performance pour comprendre l'impact du vide dans différentes disciplines.
Capacité à travailler en collectif : Esprit de collaboration et d'échange, essentiel pour participer à un atelier où l'émulation collective et la confrontation d'idées sont au cœur du processus
Cours pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Les analyses se font au fur et à mesure des problématiques rencontrées par l’étudiant lors de la définition de son programme et de son projet.
Le voyage est obligatoire et constitue le moteur d’apprentissage principal.
Le projet est mené sur l’année.
Une attention particulière est accordée à l’analyse critique, à l’organisation de la présentation graphique des documents et à la pertinence des moyens de représentation utilisés (maquettes, montage, collage, video, installation, ….)
Les étudiants seront évalués sur la démonstration de leur maîtrise de la discipline et sur leur capacité à la questionner tant sur la représentation, la composition, la programmation et sur la matérialité.
L'étudiant est invité à démontrer sa capacité à opérer des choix tout en maintenant la cohérence entre ses intentions et la concrétisation architectonique qu’il propose.
L'atelier encourage une émulation collective. Cette dynamique encourage au dépassement des visions individualistes pour viser une compréhension et une action communes. L’attention particulière portée aux idées et théories renforce cette approche, faisant de l’atelier un lieu où la pensée critique et la praxis architecturale se rencontrent et s’enrichissent mutuellement.
Références, bibliographie et lectures recommandées
voir programme détaillé
Autres renseignements
Contacts
jean.marc.sterno@ulb.be
pierre.emans@ulb.be
Campus
Autre campus
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Autre
Autre
a. Le cours est évalué de plusieurs manières :
-
Évaluation continue et implication dans un groupe d’atelier. La participation active au cours est une condition indispensable pour permettre la bonne évolution des acquis. Cette participation requière la production hebdomadaire de jeux complets de documents graphiques de qualité, en groupe et individuels et ce pour la création d’un corpus commun de références mis en partage.
-
La présentation des états d’avancements et des remises intermédiaires suivant les critères énoncés et notamment lors de pré-jurys.
-
La présentation du projet aux préjurys et aux deux jury de fin de quadrimestre
b. L’évaluation portera sur trois critères:
L’engagement de l’étudiant, la pertinence de sa démarche et la qualité du projet.
c. La thématique proposée dans le programme 2024-25 est la même pour les BA3, MA1 et MA2.
Elle constitue la colonne vertébrale des préoccupations de l’atelier.
Certaines étapes durant l’année seront le résultat de propositions en groupes (max. 3 étudiant.e.s) et/ou individuelles.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Q1 : 30% réparti en 2 parties
-
9% pour la cote d’atelier (présences, investissements, remises intermédiaires)
-
21% pour le jury de décembre (avec membres de jury invités extérieurs)
Q2 : 30% réparti en 2 parties
-
12% pour la cote d’atelier (présences, investissements, remises intermédiaires)
-
18% pour la remise de mars 2025
JURY de fin d’année : 40% (avec membres de jury invités extérieurs)
La SIP se déroule au second quadrimestre, et fait partie de l'UE Projet. Son mode de cotation et son poids dans la construction de la note de l'UE Projet seront précisés ultérieurement dans le cours du premier quadri de cette année académique.
Langue(s) d'évaluation
- français