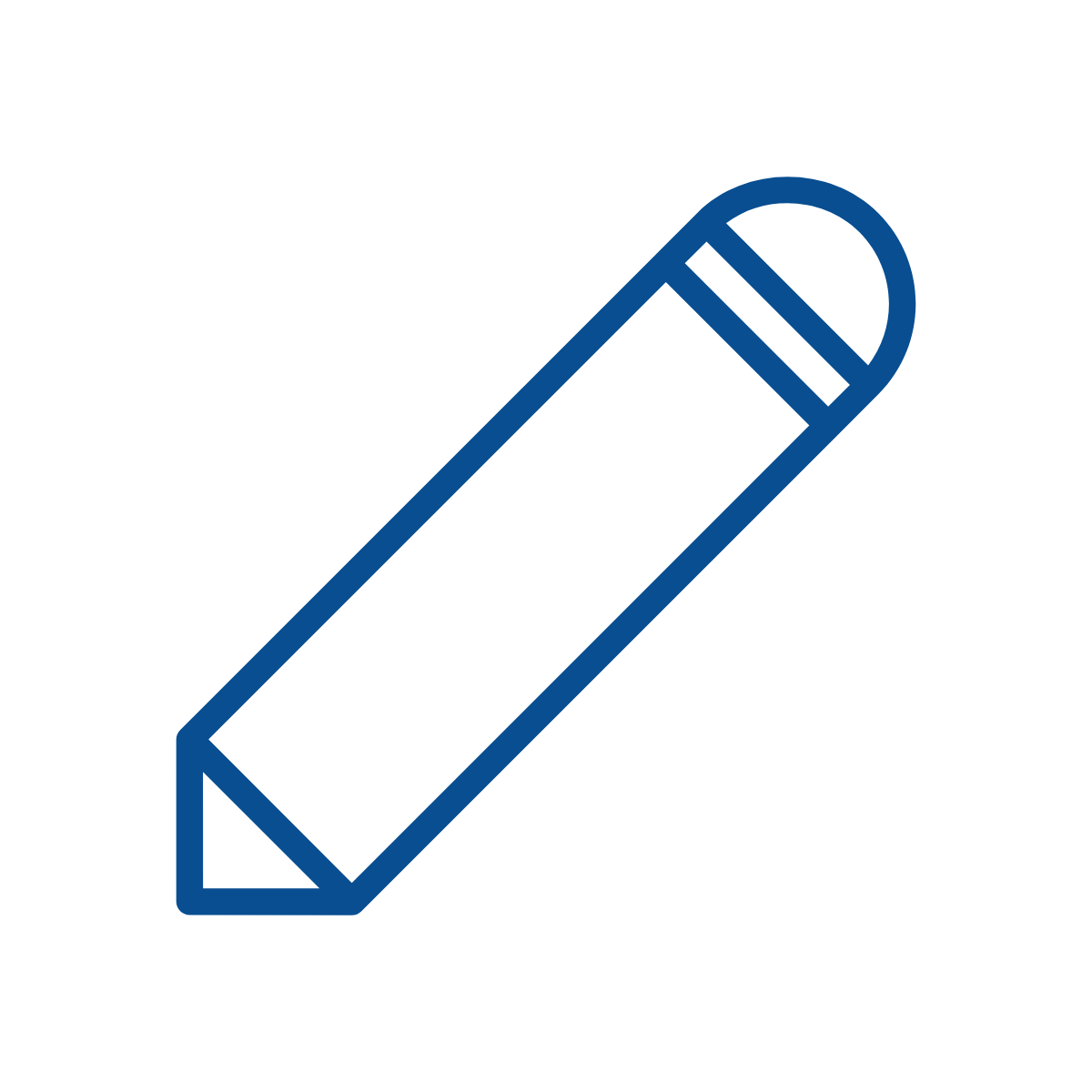-
Partager cette page
Séminaire : Dispositifs collaboratifs dans le non marchand
Titulaire(s) du cours
Aline BINGEN (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Un exposé théorique rappelle les différents éléments vu au cours en Bloc 1. En fonction des disponibilités de certains acteurs/experts de terrain, des exposés peuvent être planifiés pendant le séminaire et concerner des projets concrets. Les autres séances sont consacrées à l’avancement du travail (travail en bibliothèque, démarche exploratoire, entretiens de terrain, entretien avec l’assistant).
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Ce séminaire s’inscrit dans la suite logique du cours « Diagnostic et gestion de projets » (SOCA - D544 dispensé au Bloc 1) qui a pour objectif, notamment, d’introduire aux différentes méthodologies de gestion des projets (non marchands) en insistant sur celles qui se déroulent en plusieurs étapes, de la conception du projet à son organisation, son suivi et son contrôle et enfin son évaluation. La gestion des risques est également abordée. L’objectif de ce séminaire est une mise en pratique des principes, des étapes, des notions et des concepts étudiés lors de ce cours en réalisant un travail de terrain.
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Il ne s’agit en aucun cas d’un cours ex-cathedra mais d’un séminaire dont la démarche se veut interactive. C’est pourquoi la présence de tous les étudiant(e)s est obligatoire et une participation active est demandée. Toute absence à une séance sera (préalablement) justifiée par mail. Lors des trois dernières séances, les étudiant(e)s sont amené(e)s à présenter oralement l’état d’avancement de leurs travaux. Lors de ces présentations orales, les étudiant(e)s concerné(e)s doivent impérativement être présent(e)s et participer activement à la présentation (l’assistant pourra éventuellement poser des questions sur le travail en cours). Cette présentation n’est pas cotée mais doit idéalement susciter des débats avec les participants au séminaire et peut faire l’objet d’observations de la part de l’assistant. L’ordre de passage sera fixé lors de la première séance du séminaire (il est important de répartir équitablement le nombre de groupes par séances prévues à cet effet). La bibliographie remise par l’assistant lors de la première séance est un outil indispensable pour conduire la réflexion et pour réaliser le travail (voir ci-après). Les étudiant(e)s sont toutefois invité(e)s à compléter leurs lectures par d’autres sources. Ce séminaire exige donc des étudiant(e)s un travail important de recherche/lectures et de démarches afin de réaliser le travail. Tout au long de l’année, l’assistant est disponible par mail et reçoit en entretien individuel les étudiant(e)s qui rencontrent des difficultés particulières.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Boutinet J-P., Psychologie des conduites à projet, Paris, P.U.F., 1999, coll. « Que sais-je ? ».
Boutinet J-P., Anthropologie du projet, Paris, P.U.F., 3ème édition, février 2015, coll. « Quadrige ».
Autres renseignements
Contacts
dimitri Léonard (dimitri.leonard@ulb.ac.be)
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Autre
Autre
L’évaluation porte sur un travail écrit réalisé par groupes de 2 (10 pages environ) ou de 3 personnes (15 pages environ). La composition des groupes - une fois fixée - ne pourra en aucune manière être modifiée (à moins de circonstances particulières à justifier). Ce travail comprend : la description d’un projet, librement choisi, finalisé ou en cours ; une analyse « à plat » des éléments constitutifs d’un projet et des différentes étapes qui le caractérisent : définition, conception, organisation, objectifs, ressources, gestion des risques, planification, évaluation, diagnostic ; une analyse critique sur base d’une revue de la littérature - voir notamment la bibliographie remise par l’assistant lors de la première séance. Cette analyse doit également faire intervenir certains développements théoriques issus de l’ouvrage mentionné ci-dessous : Boutinet J-P., Anthropologie du projet, Paris, P.U.F., 3èmeédition, février 2015, coll. « Quadrige ».
La répartition entre la description, l’analyse et la critique doit être équitable. Ces différentes parties peuvent être présentées point par point mais aussi sous la forme d’une analyse critique globale, comme si les étudiant(e)s rédigeaient un article scientifique. La bibliographie doit être pertinente, c’est-à-dire rédigée selon les règles et normes en vigueur et être exploitée dans le texte. Tout plagiat fera l’objet d’une sanction.
Au niveau de la forme, le travail dactylographié (Time News Roman, taille 12 à titre indicatif) sera imprimé uniquement en recto et les pages seront numérotées. La page de garde mentionne l’identité des étudiant(e)s) et le titre du travail.
La date du dépôt du travail est déterminée lors de la première séance. Le travail écrit doit être remis pour la date décidée en version papier au secrétariat (Mme Delphine DEFOSSE) et doit également être envoyé par mail (dimitri.leonard@ulb.ac.be). Il va de soi que les étudiants peuvent déposer le travail avant la date ultime. Une séance de visite des copies est fixée en fin d’année.
Attention : pour la seconde session, les étudiant(e)s doivent réaliser obligatoirement un travail individuel de 8 pages (sur le fond, les consignes sont identiques à la première session).
Langue(s) d'évaluation
- français