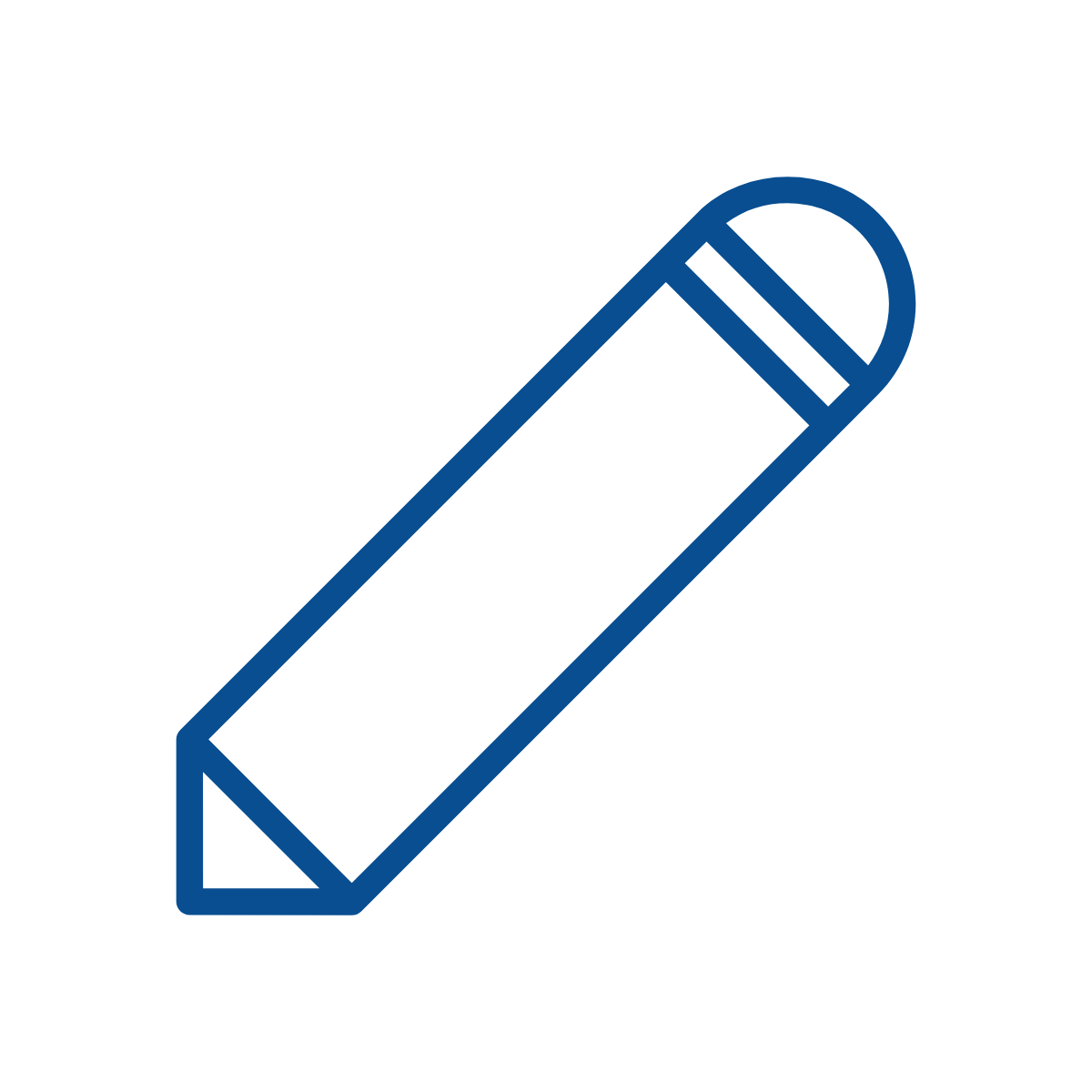-
Partager cette page
Projet d'architecture 3.15 :BIHH - Brussels Innovative Housing Hypothesis
Crédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
L'atelier BIHH (Brussels innovative housing hypothesis) est entièrement consacré au projet de logement en Région de Bruxelles-Capitale. Il se saisi de situations contemporaines pour développer ses exercices. Y sont examinées, étudiées et développées de nouvelles formes d’habitat, tant à partir de modèles existants que de l’étude de nouvelles tendances. Par des analyses de cas et des sujets d’études interpellant, l’atelier souhaite être un vivier pour le développement de projets portant la réflexion sur des formes innovantes d’habitat en réponse aux changements des modes de vie actuels et futurs tant à l’échelle urbaine qu’à l’échelle domestique.
L’atelier vise à former de futurs architectes par essai et expérimentation du projet. L’intention est de développer une vision prospective aux enjeux liés à l’espace domestique urbain. Il forme les étudiants à développer une lecture critique architecturale des pratiques et des contextes existants, exprimée par le projet d’architecture et ses outils de représentation, en vue de formuler des espaces d’habitat à Bruxelles en phase avec les enjeux économiques et urbains futures. Ainsi les programmes proposés, émanant en partie des acteurs du développement du logement à Bruxelles, sont axés sur le caractère innovant des réponses à formuler, à la différence des programmes conventionnels du type « étude de faisabilité ».
Cette posture d’innovation est portée par la synthèse entre recherche documentaire et recherche par le projet.
L’atelier s’intéresse aux enjeux et défis urbains contemporains en proposant des hypothèses à la marge des politiques et pratiques du territoire. En collaboration avec les acteurs urbanistiques locaux, l’atelier travaille à la mise en forme spatiale et technique de spéculations du « comment cela pourrait-être autrement ». Par la formulation de proto-projets, instruments d’expérimentation et de communication, l’atelier voudrait contribuer à faire avancer la réflexion sur la ville de demain.
Le cadre de travail est essentiellement Bruxelles. L’immédiateté, mais également la singularité historique et vécue de cette ville-région en font le territoire idéal de l’acquisition de connaissances mais également du questionnement.
L’ambition pédagogique par une interrogation hors des sentiers battus, est de mieux appréhender le concret et en filigrane interroger les méthodes du projet.
L’analyse et le relevé (acquisition de connaissance) sont présents tout au long de l’année, mais le projet d’architecture et ses représentations restent l’outil privilégié de l’atelier.
Une continuité de la thématique et une progression en charge sont prévues au cours de l’année mais les deux quadrimestres restent distincts afin de favoriser la prise de risque et la remise en question des étudiants comme l’intégration en cours d’année des étudiants Erasmus.L’ambition pédagogique par une interrogation hors des sentiers battus, est de mieux appréhender le concret et en filigrane interroger les méthodes du projet. L’analyse et le relevé (acquisition de connaissance) sont présents tout au long de l’année, mais le projet d’architecture et ses représentations restent l’approche privilégiée développée à l’atelier.
L’atelier propose des énoncés mesurés et adaptés au nombre et à la motivation des étudiants tout au long de l’année académique. De septembre à mai, les énoncés des exercices sont progressifs pour permettre d’acquérir les connaissances nécessaires et de développer au Q2 un exercice de synthèse. Une continuité de la thématique et une progression en charge sont prévues au cours de l’année mais les deux quadrimestres restent distincts afin de favoriser la prise de risque et la remise en question des étudiants comme l’intégration en cours d’année des étudiants Erasmus.
L’atelier articule son enseignement sur deux aspects. D’une part il y a l’étude et la lecture de ce qui constitue la majeure partie du tissu urbain bruxellois pour en comprendre la richesse au niveau de la diversité architecturale et urbaine, mais aussi les caractéristiques et fonctionnements au cours du temps. D’autre part on propose des énoncés d’exercices qui adoptent des postures exploratoires innovantes permettant d’imaginer de nouvelles configurations.
Les énoncés invitent à interroger les rapports d’espaces possibles du purement privé au purement public en passant pas tous les intermédiaires possibles. Ainsi les contraintes fonctionnelles, de dimensionnement, de qualité d’éclairage naturel, de ventilation et d’accessibilité sont étudiées en prenant en considération les contraintes de société : inclusion sociale, esthétique urbaine, santé publique, adaptabilité.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
- Expérimenter pour interroger et tester de nouvelles normes d’habitabilité.
- Analyser théoriquement et pratiquement un projet de logement donné et y déceler tant les qualités spatiales que les inconvénients.
- Développer une culture de projets de logements à Bruxelles et pouvoir s’y référer par le dessin et le discours comme exemples ou contre-exemples.
- Distinguer, tant dans une analyse que dans les projets développés, entre « constants », « enjeux », « intentions » et « moyens » d’un projet de logement.
- Acquérir le vocabulaire spécifique au logement urbain pour qualifier ses différents espaces de manière exacte et en relever les caractéristiques et les spécificités.
- Concevoir et représenter correctement au niveau graphique et par maquette un ensemble de logements de l’échelle urbaine de l’échelle 1/0000 à l’échelle 1/50.
- Plan de situation, plans d’implantation, plan du rez-de-chaussée, plan des étages, coupes longitudinales et transversales, façades, représentations de l’extérieur dans son contexte urbain et de l’intérieur (croquis, 3D, perspectives, …)
- Comprendre le but et les limites des règlementations liées au logement à Bruxelles.
Objectifs d’apprentissage spécifiques par années :
Les 3 années travaillent verticalement sur le même énoncé et contexte théorique. Pour chaque exercice une différenciation des attendus par année est précisée suivant une logique progressive en termes de développement et de production.
Pour les Ba3 un périmètre d’intervention restreint et ou un développement partiel du sujet est demandé pour chaque exercice. L’objectif est une maîtrise de l’échelle proposée dans la conception, la mise en forme comme la représentation.
Pour les Ma1 le projet porte sur la totalité du périmètre d’intervention et sur des développements ciblés dans celui-ci. L’objectif d’apprentissage est la maîtrise des différentes échelles et leurs transversalités tant au niveau de la conception que de la mise en forme et de la représentation.
Pour les Ma2 le projet porte sur la totalité du périmètre d’intervention et sur la totalité du développement. L’objectif d’apprentissage est la maîtrise complète du projet à ses diverses échelles, du projet urbain au détail architectural, au niveau de la conception, de la mise en forme et de la représentation.
Pour les MA1 et les Ma2, sous réserve d’un accord préalable, l’exercice pourra être adapté en fonction des centres d’intérêt gravitant autour du TFE et des Questions d’architecture de chacun.
L’atelier propose des énoncés mesurés et adaptés au nombre et à la motivation des étudiants tout au long de l’année académique. De septembre à juin, les énoncés des exercices sont progressifs pour permettre d’acquérir les connaissances nécessaires et de développer à la fin du Q2 un exercice de synthèse.
Pré-requis et Co-requis
Cours pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Le projet est mené individuellement. Il est demandé à l’étudiant d’avoir une grande autonomie. Il est exposé à l’atelier hebdomadairement et confronté au travail des autres étudiants lors des affichages et corrections collectives. L’enseignement est collectif tout en étant tributaire d’un bon avancement individuel d’une séance à l’autre.
Au sein de l’atelier vertical, l’énoncé comme la thématique sont communs pour toutes les années d’études afin de créer une synergie entre tous les étudiants. Une variation dans le développement des différents exercices est proposé pour correspondre au niveau d’études.
Un planning du contenu des séances est communiqué en début d’année académique et de chaque exercice.
Les activités d’apprentissages sont organisées par rapport aux deux grands projets de l’année (un par quadrimestre), mais aussi des plus petits exercices, de l’analyse dessinée, de l’analyse in situ, des conférences d’experts, …
Une attention particulière est accordée vers la fin d’un exercice à l’organisation de la présentation graphique des documents finaux.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Sur l’habitat à Bruxelles :
LEDENT, G. et POROTTO, A., Brussels Housing. Atlas of residential Building Types, Birkhäuser, 2023.
AVERMAETE, T. Van DE PAER, T., FALLON, H., Real life Brussels, Spectormag GbR, 2024.
SANSEN, J., RYCKEWAERT, M., Collective Housing : a new habitat for living in Brussels, VUB Press, 2021.
Sur l ’habitat en général :
LEDENT, G. et POROTTO, A., Brussels Housing, Atlas of residential building types, Birkhäuser, 2023
HECKMANN, O, SCHNEIDER, F.,(ed). Floor Plan Manual Housing. Basel, Birkhäuser, 2011.
LUCAN, J., Habiter. Ville et architecture. EPFL Press 2021.
SCHMID, S., A History of Collective Living. ETH Zürich et Brikhäuser, 2021
SHERWOOD, R. Modern housing prototypes. Cambridge and London, Harvard University Press, 1978.
LEUPEN, B., MOOIJ, H., Housing Design. A Manual. TUDelft, 2011
VAN GAMMEREN, D., KUITENBROUWER, P., SCHREURS, E., DASH, Home work city Rotterdam, Nai Publishers.
Support(s) de cours
- Université virtuelle
Autres renseignements
Informations complémentaires
Les supports du cours sont transmis via le groupe TEAMS de l'atelier qui est commun à toutes les années: GRB_Atelier BIHH.
Les documents requis pour les remises intermédiaires et pour les jurys certificatifs sont à déposer conformément aux énoncés d'exercices sous forme de "devoirs" émis par et le groupe Teams d'atelier par année d'étude :
Ba3 => PROJ-P3315-202425; M1 => PROJ-P4315-202425; M2 => PROJ-P5315-202425.
Contacts
Jean-Marc.Simon@ulb.be
Campus
Autre campus
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Projet
- Autre
Projet
Autre
Le cours est évalué de 3 manières :
- Le dépôt de l’état d’avancement hebdomadaire sur TEAMS/ devoir. (Auto-évaulation)
- La participation active au cours est une condition indispensable pour permettre la bonne évolution des acquis. Cette participation requière présentation hebdomadaire de jeux complets de documents graphiques de qualité avec un état d’avancement à discuter en atelier. (Évaluation formative).
- La présentation du projet au jury suivant les critères de l’énoncé. (Évaluation certificative)
Critères d’appréciation pour les épreuves certificatives
- La grille d’évaluation (B3 et Ma) de la faculté est d’application.
- Qualité, originalité et pertinence de la proposition d’expérimentation/innovation architecturale
- Prise de risque de la proposition
- Qualité de la traduction spatiale des idées
- Respect des consignes
- Qualité et pertinence graphique des documents
- Cohérence entre dessins et affirmations
- Cohérence globale des arguments (rapport entre les analyses et les propositions).
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
La pondération est conforme aux décisions du CEP de la Faculté.
L’année est structurée suivant 2 grands exercices, un par quadrimestre. Chacun donne lieu à deux évaluations certificatives distinctes portant sur un avant-projet et un projet.
La répartition de la note d’année par quadrimestre est la suivante :
Le Q1 représente 35% de la note finale. Le Q2 représente 65% de la note finale d’année.
La note du Q1 est basée sur 2 jurys certificatifs : le n°1 (15% de la note d’année) et le n°2 (20% de la note d’année).
La note du Q2 est basée sur 3 jurys certificatifs : le n° 3 (15%), le n°4 (20%) et le n°5 (30%).
La note d’année des B3 et M1 intègre également la note acquise lors de la SIP.
La SIP se déroule au second quadrimestre, et fait partie de l'UE Projet. La SIP est une semaine d’innovation pédagogique qui n’est pas encadrée par l’atelier. Son mode de cotation et son poids dans la construction de la note de l'UE Projet seront précisés ultérieurement.
Langue(s) d'évaluation
- français
- (éventuellement anglais )