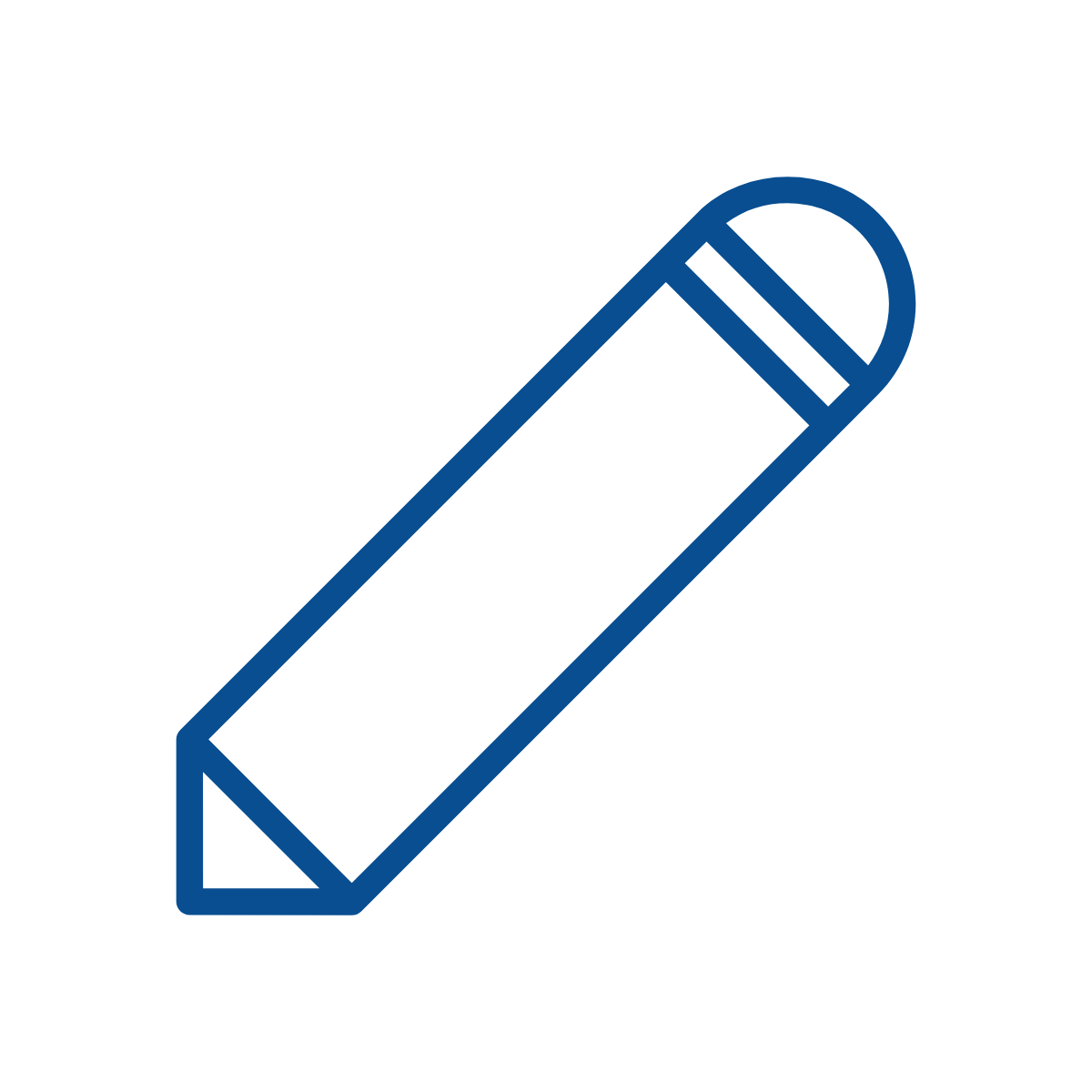-
Partager cette page
Projet d'architecture 4.16 : CUMA - Club d'utilisation du matériel architectural
Crédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Ces compétences sont transmises à travers deux exercices :
- Un exercice de recherche : atlas, cartographies, textes, maquettes, etc...
- Un exercice de spéculation : le projet final illustré par un nombre limité de documents de qualité.
Une attention aux productions matérielles spécifiques à la discipline architecturale.
Nous entendons par productions matérielles, les moyens de représentation, les dessins, les maquettes, les publications permettant de mettre à l’épreuve le projet avant sa concrétisation. L’atelier cherche à donner plaisir et aisance dans ces savoirs artisanaux qui sont à la fois les outils de recherche et de communication du fait architectural. La pratique de l’architecture est conçue comme acte de médiation. L'architecte est le partenaire à qui l’on reconnaît le droit et le savoir de préfigurer l’espace à venir. Celui qui à travers ses outils de représentation peut rendre perceptible et partageable les qualités en puissance d’une configuration spatiale. L’atelier exige un grand investissement dans la qualité des productions physiques.
- Une attention à la culture architecturale et à la recherche et la manipulation des références.
Les projets sont toujours mus par une exigence de filiation, de parenté. Cette attention cherche à aiguiller les étudiants dans la recherche de ressources et leur manipulation, à leur permettre de constituer un bagage intellectuel et de bonnes pratiques rendant l’acte de conception moins solitaire. A la figure de l’auteur héroïque mu par son inspiration est préférée celle d’un amateur éclairé, d’un architecte éditeur travaillant par cut-up et remix de matériel issu tant de la culture architecturale savante que populaire. L’atelier exige un grand investissement dans la recherche de ressources théoriques et iconographiques, dans leur analyse et leur actualisation.
- Une attention aux enjeux du “nouveau régime climatique” et ses effets sur la discipline architecturale.
Les perspectives dramatiques en termes de climat et les tensions fortes sur les ressources imposent un pas de côté important vis-à-vis de notre imaginaire architectural. Imaginaire encore aujourd’hui essentiellement issu d’une société extractiviste dont l'aveuglement progressiste est à largement interroger. L’atelier essaye de questionner les leitmotivs fanés de la conception architecturale actuelle en se plaçant au niveau des conséquences de l’acte construit tant sur les humains que les non-humains, en resituant la matière et la technique comme agent actif du processus de conception architecturale, en faisant des hypothèses spéculatives sur une architecture gouvernée par l’attention au monde plutôt que par la volonté de se distinguer. L’atelier exige un intérêt pour les questions techniques, philosophiques et politiques liées au “nouveau régime climatique” et pour les auteurs porteurs de ces enjeux (voir bibliographie)
Pré-requis et Co-requis
Cours ayant celui-ci comme pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
L’atelier se déroule sur une année complète.
Le premier quadrimestre est consacré à un processus de recherche autour d’une thématique proposée par les enseignants. Cette thématique est liée aux enjeux du “nouveau régime climatique”.
Selon le nombre d’étudiants inscrits le travail de groupe sera envisagé sachant qu’il est attendus entre 15 et 20 recherches et projets.
Nous proposons de constituer des groupes mélangés entre bacheliers et master afin d’assurer la verticalité des échanges des savoirs.
Quadrimestre 1_ Mise en condition recherche et représentation
Le premier quadrimestre consiste à déployer une lecture sous forme d'atlas et d'aboutir à un scénario de projet. Il s’agit d’un travail de recherche théorique et architectural qui exige investissement, rigueur et esprit critique. Une liste de sujets de recherches sera élaborée avec enseignant·es et étudiant·es, grâce échanges organisés en début de quadrimestre. Les recherches formeront une perspective sur le thème de l'année .
Les recherches seront matérialisées sous forme d’atlas d’images, réunis dans une publication commune et respectant un canevas proposé par les enseignant·es. La remise du 1er quadrimestre sera complétée par la production de maquettes à grande échelle. Les maquettes respecteront les consignes communes proposées par les enseignant·es.
Quadrimestre 2_ spéculation, hypothèses, représentation
Sur bases des recherches du 1er quadrimestre les étudiant·es soumettront un scénario de projet. L’énoncé du projet n’est pas donné par les enseignant·es mais construit par les étudiant·es à partir des sujets et interrogations rassemblés lors du 1er quadrimestre. Le scénario de projet ne dépend pas d’un programme : nous parlerons de dispositifs spatiaux, d’atmosphères, de structures d’édifices de plateformes d’usages mais pas de programmes. Les projets ne sont pas pensés comme des résolutions de problèmes mais comme des spéculations aptes à ouvrir et engager la réflexion.
Références, bibliographie et lectures recommandées
transmise en atelier
Autres renseignements
Contacts
Thierry Decuypere
thierry.decuypere@ulb.be
Sophie Dars
sophie.dars@ulb.be
Campus
Autre campus, Flagey, Hors campus ULB
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Projet
- Présentation orale
Projet
Présentation orale
Deux modes d’évaluation sont prévus :
L'évaluation est composé de deux types de cotation
1. Une évaluation formative continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e (avec remises intermédiaires, aux dates convenues, de l’état d’avancement des recherches, et projets de groupe et individuels) et sa participation active et engagée durant les ateliers. Ces évaluations formatives seront communiquées à l’étudiant·e tout au long de l’année, à l’issue des moments-clé, avec une synthèse de celles-ci à l’issue du premier quadrimestre.
2. Des évaluations certificatives à l’issue de chacun des quadrimestres.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
La pondération de la note de l’UE se base sur les évaluations certificatives, selon la pondération suivante :
POUR LES BA3 / MA1
- Évaluation certificative du Q1: 40 %.
Appréciation du travail en atelier le : 20 %
Jury de fin de quadrimestre : 20 %
- Évaluation certificative du Q2 : 60 %
Appréciation du travail en atelier le : 20 %
Jury final : 40 %
POUR LES MA2
- Évaluation certificative du Q1: 40 %.
Appréciation du travail en atelier le : 20 %
Jury de fin de quadrimestre : 20 %
- Évaluation certificative du Q2 : 60 %
Appréciation du travail en atelier le : 20 %
Jury final : 40 %
La note de l’UE Projet sera la moyenne arithmétique pondérée de ces notes certificatives.fr
Langue(s) d'évaluation
- français
- partiellement en anglais
- (éventuellement anglais )